| TRAVAUX, PUBLICATIONS - Blog
Le Business & Legal Forum devient les Business & Legal Forums
Découvrez la version beta du site internet : https://fr.blforums.com/
![[Puce]](/offres/image_inline_src/454/454_ckeditor_mailing_080318_180536_1.png) Entreprises, conseils et pouvoirs publics.
Entreprises, conseils et pouvoirs publics.
Répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Les travaux du BLF explorent et défrichent, avec des personnalités de talent, les avancées éthiques, technologiques, juridiques, économiques... Par leurs approches transverses, ils inspirent les dirigeants et les aident dans leurs prises de décisions. Plusieurs futurs sont possibles : à nous de les choisir !
| ARTICLES - Inspiration(s) | ÉTUDES - Grand Angle | GUIDES
::: VIDEOS
::: Exclusif :
les interviews du Business & Legal Forum
Résolution des litiges internationaux : pourquoi la compliance change-elle la donne ? Comment limiter les risques pénaux et réputationnels ?
- Dany KHAYAT, avocat associé, MAYER BROWN
- Eric HAZA, directeur juridique groupe, VEOLIA
- Thierry REVEAU DE CYRIERES, directeur grands contentieux, TOTAL SA
- Xavier BOUCOBZA, professeur de droit des affaires, droit de l'arbitrage, droit du commerce international, UNIVERSITE PARIS SACLAY
::: Crise, Restructuration, M&A et contrôle des concentrations : quels réflexes adopter ?
Etienne Chantrel, rapporteur général adjoint de l’Autorité de la Concurrence, l’a souligné durant la dernière édition du Business & Legal forum : depuis le mois d’aout il y a une véritable recrudescence des demandes d'autorisation d'opérations de concentration, dont de nombreuses demandes de dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations. En effet, la crise est devenue un terreau fertile pour l’acquisition d’entreprises en difficultés. Ce type de procédure se révèle crucial pour accélérer la temporalité et mieux coller aux stratégies de restructurations.
::: CONCILIER URGENCE ET ENJEUX DE CONCURRENCE

« La crise multiplie les opportunités d’acquisitions dites « prédatrices ». Le problème est que ce type d’acquisition, dont les effets peuvent être dévastateurs, échappe à l’examen préventif des Autorités de concurrence, car les seuils de déclenchement du contrôle ne sont pas atteints. Ne faut-il pas mettre en place un dispositif permettant aux Autorités de les examiner ? L’Autorité de la concurrence en France est favorable à un tel traitement, spécialement dans l’économie numérique. Il faut soutenir ses propositions qui vont dans le sens de la réalisation des objectifs du droit de la concurrence : protéger le processus concurrentiel pour faire en sorte qu’il conserve sa fonction de « stimulant » et ne se transforme pas en poison ».
Christophe COLLARD
professeur de droit, co-directeur du LL.M Law and Tax Management,
EDHEC

« Lors d’une acquisition, la temporalité est toujours une donnée clef. Elle l’est encore plus dans une période économique difficile pour les entreprises où des durées longues d’analyse par les Autorités peuvent conduire à une dégradation de la valeur de l’actif.
Avec la crise sanitaire, les demandes de dérogation vont sans doute augmenter, mais au-delà, le problème reste entier pour les opérations qui n’y seront pas éligibles. Il est important que le contrôle des concentrations tienne compte des recompositions du tissu industriel et de la mutation des modèles économiques liée à l’arrivée de nouveaux acteurs, ou au cycle d’innovation plus brutaux que ces crises entrainent.»
Gabriel LLUCH,
directeur juridique concurrence et réglementation,
ORANGE
::: LA REPONSE DES AUTORITES
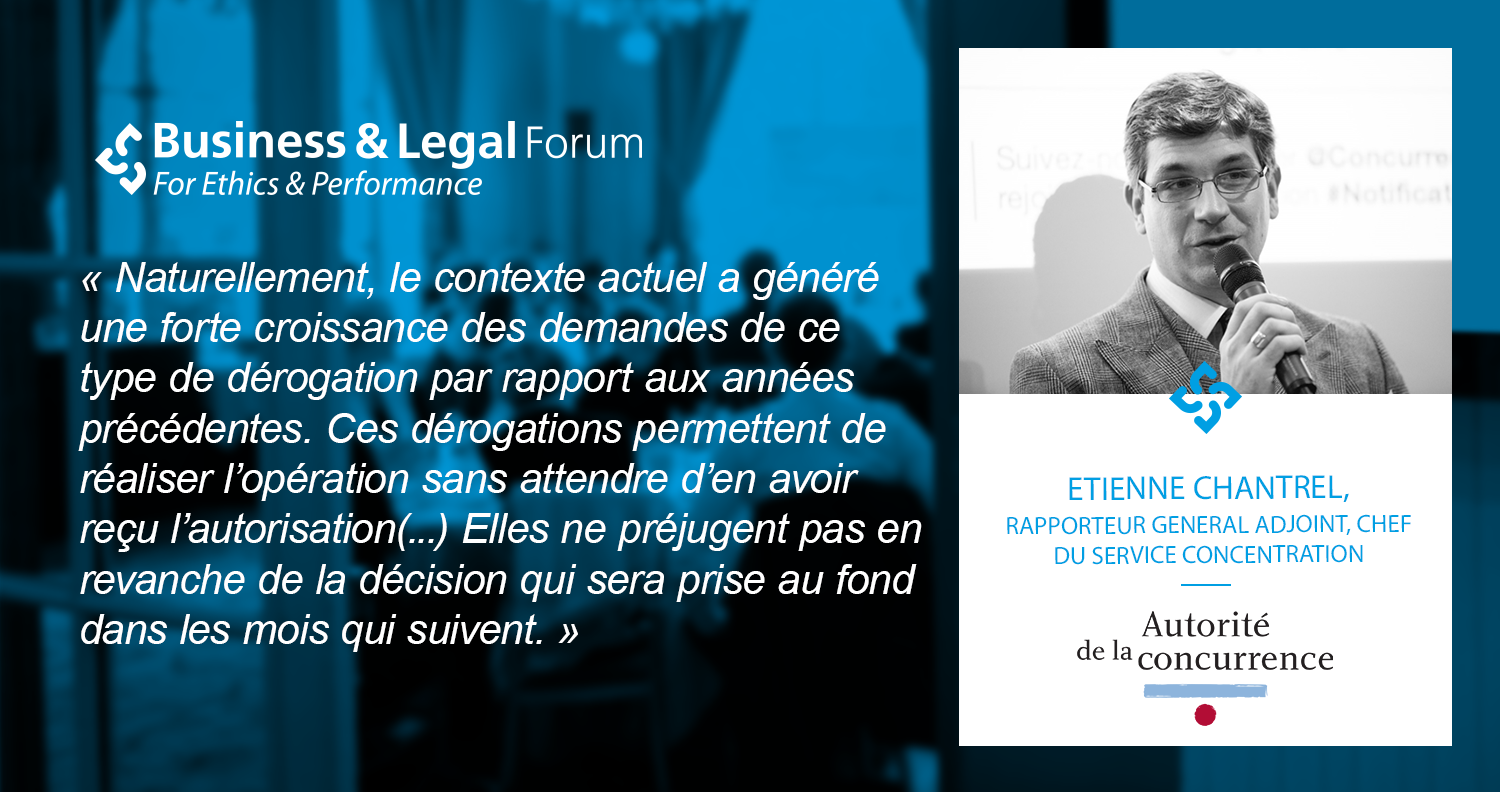
Les entreprises souhaitent toujours une analyse rapide de leur dossier. Rappelons, néanmoins que les délais sont particulièrement en contrôle des concentrations, avec un délai légal de 5 semaines après notification pour l’essentiel des décisions. Les décisions rendues après un examen approfondi (« phase 2 ») sont rares, 2 ou 3 par an sur 270 décisions au total en 2019 par exemple ».
Etienne CHANTREL,
rapporteur général adjoint, chef du service concentration,
AUTORITE DE LA CONCURRENCE
::: QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE LORS D'UNE DEMANDE DE DEROGATION ?

«Dans le cadre d’une demande de dérogation, il est essentiel d’établir une bonne coopération avec les équipes de l’Autorité, et de leur fournir des documents le plus clairs possibles, afin de leur permettre d’évaluer la possibilité d’une dérogation dans des délais très serrés. Par ailleurs, les parties doivent identifier, dans toute la mesure du possible, d’éventuels problèmes de concurrence sur le fond, ce qui parfois peut ne pas être aisé dans l’urgence. En effet, si l’Autorité doit in fine demander des engagements, voire interdire l’opération, cela peut soulever des problèmes considérables si l’opération a d’ores et déjà été réalisée. Pragmatisme et rigueur sont fondamentaux.»
Marta GINER ASINS,
avocate associée,
NORTON ROSE FULBRIGHT
::: LE LIVRE INSPIRANT: JUNK TECH, JEAN-MARC BALLY & XAVIER DESMAISON

Jean-Marc Bally est président d’Aster, société de capital-investissement implantée à Paris, Londres, San Francisco, Tel Aviv et Nairobi. Il témoigne de plus de 20 ans d’expérience de succès - et d’échecs - dans l’accompagnement de start-up.
Xavier Desmaison est président d’Antidox, groupe de conseil en stratégie de communication et co-président de Monolith Partners, agence de technologies marketing.
Les entreprises de la Silicon Valley parviennent à entretenir la légende qu’elles tirent leur réussite de leur supériorité technologique et de leur génie créatif. La réalité est plutôt qu’elles entretiennent l’accoutumance des consommateurs - et des investisseurs - par un subtil alliage entre leur aptitude à saisir l’air du temps et les aspirations individuelles, et leur pouvoir de façonner des mythes qui entrent en résonnance avec les désirs d’individus narcissiques. Bienvenue dans l’ère de la Junk Tech dominée par les dealers de rêves !
Ce livre se veut source de propositions pour que l’Europe recolle avec le dynamisme des succès observés en Californie : la compétition se joue sur la capacité à construire et communiquer une offre cohérente, en redonnant au marketing un rôle essentiel dans la mise en œuvre des stratégies d’innovations.
::: ANTICORRUPTION : quel bilan et perspectives ?
L'AFA lance une consultation publique avant de publier des nouvelles recommandations.
L’AFA a ouvert une consultation publique avant de publier ses nouvelles recommandations. Après trois années d’existence, quelles leçons tirer et quelles perspectives pour les entreprises et la pratique judiciaire ?
Sujet abordé le 15 octobre lors du Global Anticorruption & Compliance Summit (GACS) : alors que les approches sont assez disparates selon les entreprises, le GACS a été l’occasion de mettre en lumière des pistes pour améliorer l’implémentation de la conformité et de la lutte contre la corruption.
::: ENTRE REALITES DE L'ENTREPRISE ET MODELE JURIDIQUE : UNE SITUATION DISPARATE.

Si leurs situations restent disparates en matière de lutte anti-corruption, beaucoup d’entreprises ont assimilé les exigences issues de la loi Sapin II et intégré les bonnes pratiques de coopération avec les autorités réglementaires et de poursuite, comme le montre la CJIP Airbus. Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des contrôles opérés par les juridictions pénales et civiles, parfois même d’un glissement vers la méthode du faisceau d’indices pour fonder des décisions d’exequatur ou d’annulation de sentences arbitrales. A l’étranger, des décisions récentes laissent par exemple espérer une inflexion de la jurisprudence américaine en matière extraterritoriale du FCPA.
Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne, avocats associés,
BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES
::: QUELS MOYENS ALLOUER ?

Les contrôles constituent une opportunité d’affiner les recommandations de l’AFA afin d’améliorer leur efficience et leur implémentation. L’AFA a la volonté d’accompagner les entreprises dans la lutte contre la corruption et ouvre une consultation publique invitant les acteurs privés et publics à faire part des enjeux clefs avant la publication de nouvelles recommandations.
Cette implication des entreprises est nécessaire pour faire émerger des idées concrètes et des propositions d’améliorations qui enrichiront le contenu des recommandations formulées par l’Agence. (lien : participer à la consultation).
Charles Duchaine, directeur, AFA
::: NOUVELLES VOIES DE RÉFLEXIONS POUR L'AFA

Si les politiques de conformité sont de plus en plus respectées par les entreprises françaises, un optimum ne pourra pas être atteint tant que les pouvoirs publics ne reconnaîtront pas l'importance de la "corruption passive" : les entreprises sont les victimes de sollicitations et d'extorsions émanant d'agents publics indélicats. Il est essentiel d'obtenir le soutien des autorités pour "résister" et non plus juste sanctionner.
Par ailleurs, l'obligation de conformité doit s'appuyer sur des démarches éthiques. Les process coercitifs et répressifs ont des limites intrinsèques. Une part accrue des décisions doivent être confiées aux collaborateurs chargés de faire des arbitrages responsables.
Pour ce faire, les compliance officers ont l'obligation de promouvoir des mécanismes d'appropriation et d'assistance aux salariés, en suscitant la confiance et le dialogue. En un mot, en passant d’une éthique " subie " à une éthique " vécue."
Dominique LAMOUREUX, membre du conseil stratégique, AFA
::: LE POINT DE VUE DE L'ENTREPRISE

Il est maintenant (quasiment) admis que la compliance, d’abord vécue comme une contrainte, est en réalité une opportunité de progrès pour les entreprises. Plus qu’un simple respect des règles, elle tend vers une intégrité, source de valeurs. Dans cette démarche, les salariés peuvent s’approprier les process de compliance pour les inciter à participer au développement d’une culture d’intégrité dans l’entreprise et donner du sens à ces procédures compliance. Les mécanismes d’adhésion des salariés sont un axe à travailler en complémentarité de la mise en place de processus préventifs et coercitifs pour arriver à une organisation compliance parfaitement efficace.
Jean-Baptiste SIPROUDHIS,
directeur éthique, intégrité et responsabilité d'entreprise, THALES.
::: LES PLUMES ET CAMERAS DE L'ECONOMIE & DU DROIT

Cet article éclaire ce qu’est le droit d’alerte ou whistleblowing (les principes constitutionnels issus du 18ème siècle, l’évolution des définitions et législations au 20ème siècle) et retrace, étape par étape, la fabrication de la définition française du lanceur d’alerte, au plan conceptuel (aboutissement du droit comparé) et politique (rare co-construction de la société civile, du Conseil d’Etat, du gouvernement et du Parlement). Les enjeux, que l’on retrouvera lors de la transposition de la directive européenne. Il précise le rôle joué par Transparency International, à l’origine du concept "menace ou préjudice pour l'intérêt général", formalisé par le Conseil de l'Europe, comme du chapitre II de la loi Sapin 2.
Nicole-Marie MEYER.
Les Plumes et Caméras de l'économie & du droit sont des prix récompensant les meilleurs articles et vidéos croisant des enjeux économiques et juridiques.
Voir tous les Lauréats 2020.
Et si vous soumettiez votre création ? Prochaine Cérémonie le 14 octobre 2021.
Plume d'or 2020
catégorie prospectif ou innovation juridique presse professionelle
" Une définition du lanceur d'alerte énumérative ou conceptuelle? La réponse française, unitaire."
Nicole Marie MEYER est ancienne diplomate et lanceuse d’alerte dans la fonction publique ayant fait jurisprudence en droit public en 2007. Elle est desormais responsable « alerte éthique » de Transparency International France et experte près Transparency International, le Conseil d’Etat français et les institutions européennes. Elle a fortement contribué de 2009 à 2019 à l’élaboration comme au vote du régime général de protection des lanceurs d’alerte dans la loi dite Sapin 2 de 2016 et de la directive européenne du 23 octobre 2019 « sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. »
::: JUSTICE: QUEL AVENIR POUR LA RÉSOLUTION DES LITIGES PAR LES ALGORITHMES ?
::: ALGORITHME ET JUSTICE: UNE AVANCÉE PRUDENTE par Karim BENYEKHLEF & Valentin CALLIPEL

Il est peu de dire que la nouvelle frontière de l’intelligence artificielle s’est installée dans l’imaginaire collectif des juristes. Passé une certaine phase d’effervescence, on en vient pourtant à se demander, si ce soudain regain d’intérêt pour la thématique de l’incidence des techniques sur la justice n’opère pas tel un trompe-l’œil. La chimère du juge-robot comme l’éventuelle substitution de l’avocat par l’algorithme soulève une telle charge émotionnelle qu’elle occulte les réelles mutations qui affectent la résolution des litiges.
Les outils qu’utilisent les professionnels du droit doivent être distingués de la résolution des litiges. Le développement d’outils, fondés sur des formes sophistiquées d’IA comme l’apprentissage automatique, concerne essentiellement les praticiens et porte sur la recherche juridique ou l’aide à la décision sectorielle (par ex. évaluation d’un préjudice). Leur influence sur l’avenir du règlement des litiges opère donc essentiellement à la marge puisqu’elle maintient le juriste en position d’expert et d’intermédiaire au cœur de l’écosystème de justice.
LIl est peu de dire que la nouvelle frontière de l’intelligence artificielle s’est installée dans l’imaginaire collectif des juristes. Passé une certaine phase d’effervescence, on en vient pourtant à se demander, si ce soudain regain d’intérêt pour la thématique de l’incidence des techniques sur la justice n’opère pas tel un trompe-l’œil. La chimère du juge-robot comme l’éventuelle substitution de l’avocat par l’algorithme soulève une telle charge émotionnelle qu’elle occulte les réelles mutations qui affectent la résolution des litiges.
Les outils qu’utilisent les professionnels du droit doivent être distingués de la résolution des litiges. Le développement d’outils, fondés sur des formes sophistiquées d’IA comme l’apprentissage automatique, concerne essentiellement les praticiens et porte sur la recherche juridique ou l’aide à la décision sectorielle (par ex. évaluation d’un préjudice). Leur influence sur l’avenir du règlement des litiges opère donc essentiellement à la marge puisqu’elle maintient le juriste en position d’expert et d’intermédiaire au cœur de l’écosystème de justice.
L’utilisation pratique d’algorithmes reste, par ailleurs, très minoritaire et peu sophistiquée dans le domaine de la résolution des litiges (par ex. algorithme d’enchères à l’aveugle). La modélisation et l’automatisation du raisonnement juridique pose toujours de nombreux défis techniques que l’International Conference on Artificial Intelligence and Law ne manque pas de souligner, tous les deux ans. Sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire de rappeler toutes les préventions d’usage qui s’impose au plan juridique en la matière.
Il est, par conséquent, encore difficile de présumer de l’influence des algorithmes sur l’avenir de la résolution des litiges. En revanche, celle du numérique dans ce domaine se manifeste déjà très concrètement et se révèle sans doute plus emblématiques des évolutions qui pourraient survenir. En effet, la simple dématérialisation des interactions, associée à l’automatisation de certaines tâches répétitives, a d’ores et déjà contribué à redéfinir en profondeur l’expérience de justice pour nombre de citoyens, en particulier pour les litiges inadaptés aux procédures traditionnelles des tribunaux et mal desservis par les professionnels du droit. Pensons à ces millions de conflits civils, administratifs ou pénaux qui trouvent dorénavant, grâce aux plateformes, des leviers simplifiés, non contentieux et abordables de résolution. Couramment appelée le règlement en ligne des conflits (Online Dispute Resolution), cette tendance favorise le règlement sans intervention humaine de millions de conflits. Bien installé Amérique-du-Nord, le règlement en ligne des conflits devient la norme et l’occasion pour les tribunaux d’amplifier le spectre de leur intervention. Pas moins de soixante-dix tribunaux opèrent déjà ainsi aux États-Unis. Et le Canada emboîte le pas. À titre d’illustration, la plateforme PARLe du Laboratoire de cyberjustice permet à l’Office de la protection du consommateur de régler, sans juge, près de 70% des conflits de consommation au Québec. En France, la Chambre nationale des commissaires de justice, utilise cette même plateforme, sous le nom de Médicys, pour accompagner près de 20 000 entreprises dans le traitement de leurs conflits de consommation. L’équipe du Laboratoire de cyberjustice vient, également, de lancer, avec la Régie du logement du Québec – le tribunal administratif comportant le plus grand nombre de dossiers au Canada – le JusticeBot. Une plateforme d’évaluation et d’assistance, entièrement automatisée, permettant au justiciable de prendre connaissance de ses droits et d’évaluer la pertinence d’engager un recours. Cette plateforme de filtrage, qui tire parti des algorithmes, est appelée, comme d’autres, à contribuer au perfectionnement du règlement en ligne des litiges, dans un espace laissé vacant par les professions du droit.
Les algorithmes ne portent donc qu’une fonction instrumentale qui, tel le pharmakon, constitue à la fois le remède et le poison. Ils peuvent donc tout aussi bien nous éloigner que nous rapprocher des objectifs que nous valorisons pour la résolution des litiges. L’adoption des algorithmes doit résulter d’un choix réfléchi et non d’un quelconque fatalisme technologique.
Karim BENYEKHLEF,
directeur, laboratoire cyberjustice
UNIVERSITE DE MONTREAL
Valentin CALLIPEL
chargé de mission, laboratoire cyberjustice
UNIVERSITE DE MONTREAL
::: ALGORITHME ET JUSTICE: LE CHANTIER DE DEMAIN par Romain DROSNE

Obtenir une réponse de la Justice dans un délai respectueux est un prérequis pour un état de droit. Les « petits litiges » ne doivent pas déroger pas à cette obligation tant ils sont nombreux et peuvent concerner le quotidien de chacun. Une marque qui tient ses engagements, un locataire qui paie son loyer, un employeur respectueux de ses salariés sont autant de conditions qui font qu’une économie prospère, que nos rapports humains sont sains et apaisés.
Céder à la pression d’une justice engorgée ?
L’analyse de 6500 petits litiges comparables dans 72 juridictions françaises montre en moyenne :
268 jours entre l’assignation et la première date d’audience
32% de dossiers audiencés faisant l’objet d’un renvoi
163 jours entre la 1ère date d’audience et le renvoi
366 jours entre la date d’assignation et le rendu de la décision
Mais ces moyennes ne sont pas représentatives de certaines juridictions très sollicitées. Dans le cas des litiges entre passagers et compagnies aériennes, qui concernent des millions de français actuellement, 41% des dossiers sont assignés au tribunal d’Aulnay-Sous-Bois. Or les dernières dates d’audience obtenues concernaient des assignations envoyées en février 2018. A cette époque, la durée entre l’assignation et le rendu de la décision constatée était déjà de 920 jours. Après la crise sanitaire, la barre symbolique des 1000 jours entre l’assignation et le rendu du jugement est largement dépassée !
Pourtant, le caractère critique de cette situation ne doit pas nous faire voir la technologie comme un pis-aller. « L’intelligence artificielle nous rendra plus humain », déclarait le champion d’échec et activiste Garry Kasparov. Dans un ouvrage dédié à l’intelligence artificielle[i], il voit cette dernière comme un outil supplémentaire, façonné par l’esprit humain et, surtout, capable d’intégrer ses valeurs. L’Intelligence Artificielle permettra de libérer les esprits de tâches itératives et sans valeur intellectuelle intrinsèque.
Un chantier collectif pour une Justice « plus humaine » ?
Les algorithmes et l’Intelligence Artificielle sont des outils qui doivent accompagner la résolution de ces petits litiges dans un temps raisonnable mais pour y parvenir il convient de garder à l’esprit quatre principes : transparence, ouverture d’esprit, respect des fondamentaux et humilité.
Le fonctionnement des algorithmes est complexe mais il peut ne pas être opaque pour les professionnels de la Justice. Les acteurs de la “Legaltech” doivent mettre à disposition des informations compréhensibles. C’est l’ensemble du système qui doit accepter le changement de paradigme.
Dans cette entreprise collaborative, l’important demeure d’être respectueux des gardes fous de la Justice. L’impartialité du cadre, le respect du contradictoire, la possibilité d’être accompagné, l’accessibilité, etc. Ces notions essentielles doivent être présentes dans chaque proposition technologique.
Des chantiers ambitieux face auxquels on ne saurait que rester humble.
Prévoir des portes de sortie et des points de contrôles éthiques et techniques est indispensable afin d’identifier et d’éviter les problèmes qui pourraient émerger. Les Modes Alternatifs de Résolution de Disputes (MARD) et plus particulièrement ceux qui utilisent les algorithmes sont déjà capables de juguler l’engorgement de certaines juridictions. Les petits litiges se prêtent très bien à l’adjonction d’une aide technologique tant pour leurs enjeux limités que pour leur grands nombres. C’est dans cet esprit que l’obligation de médiation et l’autorisation des plateformes utilisant des algorithmes ont été instaurées par la loi du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er Janvier 2020. Elle ouvre une phase de changement, certains diraient d’expérimentation, dont les résultats seront déterminants en termes d’accessibilité de la Justice.
Romain DROSNE,
Fondateur, Justice.Cool
::: UN LIVRE INSPIRANT : QUELLE RÉGULATION POUR LES NOUVEAUX ENTRANTS DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER ?
L’expression Fintech, contraction de l’anglais financial technology, s’est imposée dans les médias et pour beaucoup le mot résonne comme un glas pour le monde bancaire et financier traditionnel. La vérité, comme toujours, est plus nuancée et ces nouveaux entrants de la finance, porteurs d’innovation et parfois de rupture, sont aussi des partenaires potentiels qu’il convient de réguler quand ils offrent des services et des produits réglementés. Toute la difficulté réside dans le point d’équilibre à trouver entre la promotion de l’innovation et la protection des consommateurs.
Partner au sein de Yellaw avocats, Thibault Verbiest est spécialiste du droit du numérique, de la régulation de la blockchain et des fintech.
Agrégé des facultés de droit, directeur du M2 de droit bancaire et financier, Thierry Bonneau est professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) où il enseigne le droit bancaire, le droit des marchés financiers, la régulation bancaire et financière européenne et internationale.
::: TELETRAVAIL : QUEL EFFET DE LEVIER ? QUELLES PERSPECTIVES STRATEGIQUES, ECONOMIQUES ET JURIDIQUES ?
44 % des salariés passés au télétravail depuis le début de la pandémie se déclarent plus satisfaits par leur emploi, selon un sondage international* En Suisse, le taux d’appréciation atteint même 90 %,** En Europe, la plupart des personnes concernées citent une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Maintenir le lien social est aussi un enjeux primordiale.
« Le télétravail a amené beaucoup de satisfaction pour certains salariés, mais aussi des contraintes, des burn-out, des problèmes de management » selon Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Mark Zuckerberg déclare quant à lui que la moitié des employés de Facebook seront en télétravail à plein temps dans 10 ans.
Comment imaginer l’organisation du travail de demain et ses conséquences économiques ? Quelles adaptations dans la relation de travail ? La France peut-elle être précurseur ? Le droit du travail doit-il évoluer pour accompagner cette tendance ?
(source : *CNBC, **La Tribune de Genève.)
::: TELETRAVAIL ... ET DEMAIN ? par Arnaud Teissier

La brutalité de la crise sanitaire et le confinement généralisé qui s’en est suivi ont imposé un déploiement massif du télétravail partout où il était possible. Les organisations et les hommes ont fait preuve d’une agilité et d’une capacité d’adaptation au travail à distance qu’on ne pouvait soupçonner.
Pour autant, ce succès du télétravail ne signifie pas nécessairement qu’il va s’imposer comme LE nouveau mode d’organisation. Si la crise a permis de démontrer aux plus réticents que le télétravail fonctionne, s’il est incontestable que le télétravail peut être une partie de la réponse à l’allongement des temps de transport, à la recherche d’un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, le travail à distance ne peut être envisagé ni comme une recette miracle, ni comme une solution exclusive.
Le télétravail peut en effet entraîner des pertes de repère, un sentiment d’isolement pour les salariés, voire même favoriser une forme de détachement de l’entreprise. Le déconfinement et le retour des équipes sur le lieu de travail ont confirmé que l’entreprise est un collectif que la distance peut altérer.
Le recours massif au télétravail durant la période de confinement a constitué un formidable laboratoire, révélant les forces et les failles de ce mode d’organisation. Il faut savoir en tirer des enseignements pour ajuster le cadre juridique du télétravail.
Quelques points de repère pour envisager son succès futur : Il faut faire évoluer le format de la collaboration et du management. Le travail à distance impose au collaborateur de prendre des initiatives pour marquer son appartenance au collectif. L’éloignement impose au manager un « dosage » nouveau : il doit continuer à assurer une présence auprès de ses collaborateurs, en se gardant d’une supervision intrusive. En contrepartie d’une autonomie renforcée, le collaborateur ne doit pas négliger l’importance d’un reporting régulier et être moteur dans les échanges avec ses collègues de travail.
Il faut aussi repenser l’organisation du temps de travail. En veillant au respect de la durée légale, on peut envisager une réflexion pour raisonner non plus exclusivement en heures de travail, mais aussi en missions à réaliser.
Pour conclure, il faut préserver la souplesse inhérente à ce mode d’organisation, tant pour le salarié que pour l’entreprise. Le télétravail recouvre en réalité des formats très variés. La définition d’un cadre trop rigide, trop systématique, serait un frein à son développement.
Le télétravail, demain, sera un succès si le cadre juridique se réinvente autour de ces nouveaux enjeux.
Arnaud TEISSIER,
avocat associé,
CAPSTAN AVOCATS
::: TELETRAVAIL : PRUDENCE ET LUCIDITE par Benoit Serre

Un marqueur RH de cette crise est évidemment le télétravail découvert par nombre de salariés, de managers et de dirigeants. S’il est imprudent de comparer celui du confinement avec le vrai télétravail, pensé comme un outil de qualité de vie au travail, il demeure que cette expérience globale de plusieurs semaines laisse des traces. Les enquêtes démontrent l’appétence même si peu à peu cet emballement fait place à une prudence lucide de la part des entreprises.
Généraliser le télétravail est moins une option que simplement l’étendre à des métiers dont on pensait qu’ils ne pouvaient y avoir accès. C’est en cela une avancée plus raisonnable que vouloir à tout prix augmenter le nombre de jours qui s’établissait avant crise à 1,8 par salarié concerné.
Une enquête BCG/ANDRH de juin 2020 auprès des DRH montre que ces derniers envisagent un maximum de deux jours. C’est assez logique puisqu’ aller au-delà signifie qu’un salarié passerait plus de temps chez lui que dans son entreprise et cela modifierait considérablement la relation à l’employeur en rendant la présence sur site, signe physique de l’appartenance professionnelle, minoritaire dans la semaine de travail. Cela est d’autant plus vrai que le principal risque identifié dans cette même enquête est celui de la désunification de l’entreprise.
Il existe néanmoins un autre risque non négligeable qui est de faire apparaitre dans les organisations une nouvelle génération de « cols blancs et de cols bleus », créant une rupture entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas en raison de leur métier. On sait par ailleurs que les métiers d’encadrement sont les plus aptes à bénéficier du télétravail ajoutant encore un point de distanciation entre manager et managé au-delà du caractère absurde d’avoir demain une équipe présente et un management à distance.
Pour autant, le télétravail se développera car il est porteur d’innovation dans le digital et de meilleur équilibre de vie professionnelle/vie personnelle. C’est d’ailleurs ce dernier point qui est plébiscité par les salariés notamment dans les métropoles soumises à des conditions de transport difficiles. Fort de ce constat d’évidence, les organisations auront à réviser en premier lieu leur modèle de management pour l’adapter à cette nouvelle relation à l’entreprise fondée sur la confiance et sur l’autonomie d’organisation du travail. Elles auront aussi à s’interroger sur la configuration physique de leurs locaux dont la vocation sera plus de favoriser la coopération et l’intelligence collective que d’accueillir dans des bureaux. La généralisation du télétravail entrainera assez probablement aussi une évolution forte du rapport à la mobilité géographique. La fermeture d’un site ne se traduira plus nécessairement par la suppression des emplois qui s’y trouvent, les personnes pouvant poursuivre en télétravail total ou partiel.
Ce dernier point est important à considérer car à l’instar de Facebook qui annonce que 50% de ses effectifs seront en télétravail dans 10 ans, nous pourrions assister à une sorte de « mondialisation de l’emploi » comme nous l’avons vu pour la production industrielle basée sur les compétences autant que sur le coût. Dans cette hypothèse, les pays dont le modèle social est développé auront à faire le pari de l’hyper compétences, de l’agilité et de l’innovation s’ils veulent concurrencer les autres où la main d’œuvre tout aussi qualifiée est moins chère.
Pour toutes ces raisons rapidement évoquées, le télétravail marque sans doute le début d’une transformation du travail profonde et durable qui touchera toutes nos sociétés. En cela, il faut être prudent, ambitieux et lucide car si les emplois de demain ne sont pas ceux d’hier, ils pourraient ne pas être au même endroit non plus…
Benoit SERRE,
Partner, BOSTON CONSULTING GROUP,
Vice-Président, ASSOCIATION NATIONALE DES DRH
::: UN LIVRE INSPIRANT : ET APRES, CE QUI CHANGERAIT TOUT SANS RIEN CHANGER
Profitons de la rupture, du temps d’arrêt que nous impose la catastrophe pour non pas sombrer dans l’immobilisme, mais ouvrir des perspectives. La vie suppose le mouvement, l’énergie, c’est pourquoi l’ignorance ne doit pas entamer l’ambition, ni le doute la volonté. Volonté de donner une nouvelle signification à ce que l’on vit, ambition de modifier certains aspects de nos existences.
Subir de plein fouet de tels remous nous impose non pas des prédictions hasardeuses, mais une exigence renouvelée de lucidité. Quelles perspectives cette période ouvrira-t-elle sur notre rapport au temps, au progrès, au travail, aux autres, à soi-même ? C’est ce que la philosophe Julia de Funès esquisse dans ces quelques pages.
Julia de Funès est conférencière, essayiste et philosophe.
::: CONCURRENCE, OPTIMISATION, FRAUDE FISCALE : UNE PENALISATION AIGUISEE ?
Depuis quelques années, les Etats cherchent à accroître leur sévérité envers la criminalité financière. Ce phénomène résulte d'une double nécessité : d'une part pour les finances publiques et d'autre part pour rassurer l'opinion publique après de multiples scandales. Pourtant, la Cour des Comptes a rendu en décembre dernier un rapport, mettant en lumière, la nécessité pour l’Etat français d’accentuer ces efforts en matière de lutte contre la fraude fiscale.
Au niveau européen, la France doit encore accroître sa coopération pour lutter contre la criminalité financière transfrontière (fraude à la TVA, fraude aux dividendes). De nombreuses entreprises sont aussi mises sous pression, par l’opinion publique, pour le rapatriement du siège fiscal dans le pays où sont localisés la plupart des emplois ainsi qu’une large part de l’activité.
La période post-Covid est l'occasion de renforcer une nouvelle fois cette sévérité alors que les finances publiques sont mises à rude épreuve. Cette période doit-elle nécessairement passer par une sévérité accrue en matière d’infractions pénales financières ? Quel équilibre à trouver, pour un système juridique, entre sévérité et attractivité ?
::: LE MONDE D'APRES : FISCAL EGAL PENAL par Philippe GOOSSENS et Judith FLEURET

Coffre-fort, bilan de Bercy, contrôles fiscaux, préjudice de l’Etat, fraude aux dividendes, tant de mots pour tant d’actualités au sujet de la fraude fiscale. La première de ces actualités vient tout droit de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2020, que les juges répressifs doivent veiller à justifier que le montant des dommages et intérêts alloués à l’Etat, en qualité de partie civile, pour le délit de blanchiment de fraude fiscale, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la fraude fiscale. Sinon : bis repetita, puisque le préjudice issu de la fraude fiscale sera déjà indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard dans le cadre de la procédure fiscale.
Deuxième actualité du début de l’année très attendue : le bilan de Bercy pour l’année 2019 en matière de lutte contre la fraude fiscale et les chiffres sont notables. 10 milliards. Il s’agit du montant total encaissé par l’Etat en 2019 dont 9 milliards encaissés à la suite de contrôles fiscaux, contre 7,7 en 2018. L’Etat continue sa progression à la suite de la promulgation de la loi d’octobre 2018 relative à la fraude fiscale. Progression suffisante ? Non selon la Cour des comptes qui considère que les résultats s’inscrivent dans une tendance à la baisse.
Le Gouvernement a alors entendu la Cour des comptes en décidant en plein confinement d’augmenter les chances de l’administration en cas de contrôles fiscaux. A partir du 1er septembre 2020, les banques françaises vont devoir transmettre le nom des bénéficiaires de coffres forts. 758 000 coffres forts sont loués au sein des principales banques en France. Ce seront donc 758 000 données – outre les nouveaux coffres par la suite – en plus pour FICOBA, fichier qui liste l’ensemble des comptes bancaires en France en précisant l’identité du titulaire et qui est accessible par l’administration lors de ses contrôles.
Une bonne nouvelle au sein de ces actualités ? Les contrôles fiscaux sont suspendus ! Et, de ce fait, le droit de reprise de l’administration fiscale également jusqu’au mois d’août 2020. Mais qui dit suspension ne dit pas annulation. Mauvaise nouvelle en réalité, car les délais pour que l’administration exerce ce droit de reprise vont augmenter. A cela doit nécessairement s’ajouter la question de la prescription de l’action publique puisque, là encore, les délais de prescription ayant été suspendus, le Parquet aura davantage de temps pour poursuivre… Plus de temps pour effectuer des contrôles fiscaux, plus de temps pour poursuivre.
Mais qu’en est-il de l’Europe dans toutes ces actualités ? Elle aussi a travaillé et a rendu des copies. Notamment en mai, s’agissant de son étude sur les fraudes aux dividendes. Et là encore, les conclusions sont sans appel. Il est nécessaire de renforcer la lutte contre les fraudes aux dividendes au sein de chaque pays. Des actions fortes doivent être menées par les institutions financières et les autorités nationales.
Le ton est donné : fiscal doit rimer avec pénal ! Le bilan de Bercy en 2021 pour l’année 2020 risque donc d’être encore plus lourd. En tout cas, c’est ce que le monde d’après pense.
Philippe GOOSSENS, Judith FLEURET,
avocat associé, avocate,
ALTANA
::: REPENSER LA SIMPLICITE DU DROIT FISCAL ET SON VOLET PENAL par Catherine DAMELINCOURT

De façon unanime, la France jusqu'à encore une période récente était considérée comme peu active en matière de sanctions pénales de la fraude fiscale, les sanctions encourues étant peu dissuasives. Un revirement s’est opéré en 2012 et se poursuit depuis. L’actualité récente s'est faite l’écho de procès médiatiques dont l'objet principal était la fraude fiscale de personnes physiques ou d’institutions financières.
La pénalisation récente et croissante du droit fiscal en France tend à appréhender les agissements de fraude d'une façon plus systématique. La création du délit de blanchiment de fraude fiscale ainsi que la fin du verrou de Bercy permettent désormais à la justice de se saisir en s’affranchissant de la procédure fiscale elle-même.
Au-delà du droit interne français, un vaste mouvement orchestré par l'OCDE et dirigé par Pascal Saint Amans, Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales (CTP), a, depuis cinq ans largement transformé le paysage fiscal international et partant, a fortement accéléré la mise en place de réglementations européennes dans un objectif de lutte contre l'optimisation fiscale agressive. Celles-ci sont, pour une grande partie, déjà transposées dans le droit positif français par le jeu des directives européennes. L'influence de la « softlaw », via les consensus politiques actés lors des réunions successives du G7 (auxquelles sont présentées pour aval politique, les recommandations de l'OCDE) ont également contribué à l’accélération de la modification des législations internes dans un sens toujours plus restrictif.
Les politiques d’échange automatique d’information et de respect de règles de conformité, qui ont vu le jour, sous la pression américaine imposant unilatéralement aux institutions financières la réglementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance) ont eu un large écho en Europe qui a mis en place plusieurs dispositifs d’échange d’informations obligatoires et automatiques. Ces instruments sont de puissants outils contre la fraude à condition qu'ils s'appliquent de manière effective dans tous les pays…
Par ailleurs depuis plusieurs années, la frontière entre fraude fiscale et optimisation agressive s'est considérablement réduite et nous sommes, sous le parrainage de l'OCDE, arrivés à un tel stade de complexité que l'on peut largement douter d’une application homogène sur le long terme des nouvelles règles adoptées (et de celles en gestation) par de nombreux pays qui n'y sont effectivement pas contraints par un mécanisme législatif comparable à celui qui existe au sein de l’Europe ou, par certains pays suffisamment puissants pour considérer qu'ils n’ont pas à s'y soumettre, au vu de leur intérêt propre. La finalité de ces actions est de promouvoir une plus grande transparence dans la gestion fiscale internationale des personnes morales et des groupes en les obligeant à publier les informations fiscales pays par pays, censées donner aux autorités fiscales compétentes, une vision globale de leur politique de répartition des profits taxables et des juridictions ou elles sont redevables d'un impôt et cela afin de pouvoir adapter les politiques fiscales publiques tant sur le volet des sanctions que de l’assiette de l’impôt.
Il existe un paradoxe certain entre l’énergie vibrionnaire de l'Europe à règlementer l'optimisation fiscale et sa faiblesse structurelle à harmoniser les fiscalités nationales, ce qui serait pourtant un formidable accélérateur de croissance et de puissance économique permettant de tenir tête aux nouvelles puissances dominantes. La période Post COVID ouvre une grande incertitude dans de nombreux domaines et la priorité semble être de retrouver un rythme de croissance plus aligné sur l’intérêt propre des Européens.
Nous ne voyons pas la nécessité de renforcer le volet des sanctions et la pénalisation dans le domaine de la fiscalité compte tenu de la multiplication des règles internationales existantes en matière de transparence et de la dynamique des actions de l'OCDE notamment via le concept BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) qui guide la politique fiscale internationale. Se doter de nouvelles règles n'offre pas d’intérêt tant que l'objectif de la lutte anti-fraude n'est pas correctement identifié, ni précisément évalué. Il nous semble qu'aujourd'hui l'Europe devrait se concentrer sur une meilleure application de la TVA et des systèmes douaniers qui vont retrouver de la vigueur avec les restrictions nouvelles aux frontières, que de continuer à alourdir les dispositifs de contrôle et surveillance des « grands groupes internationaux ».
De façon plus générale et pour ainsi dire, philosophique, la meilleure arme contre la fraude fiscale est la simplicité d'un système qui ne laisse pas de prise à l’interprétation et qui embrasse le maximum de matière fiscale à des taux bas, consensuels. La France est une contre illustration de ce principe et la réglementation fiscale internationale qui sévit frénétiquement depuis 2012 n'a fait qu'aggraver la situation.
Catherine DAMELINCOURT,
présidente,
ASSOCIATION FRANCAISE DES FEMMES FISCALISTES
::: UN LIVRE INSPIRANT : QUELS DROITS FACE AUX INNOVATIONS NUMERIQUES ?
« S’il est indéniable que les technologies numériques ont bouleversé notre quotidien, un autre constat s’impose aux juristes : aucune sphère du droit n’échappe à cette transformation et l’approche trop souvent cloisonnée est inefficace pour répondre aux défis posés.
C’est dans ce contexte que l’idée d’un travail transversal – enrichi de l’expérience croisée de magistrats et d’un avocat – s’est imposée. Le fruit de cette collaboration est un ouvrage que nous avons voulu pratique et accessible au plus grand nombre, que le lecteur soit juriste, chef d’entreprise, responsable des systèmes d’information ou citoyen. » MQ – CW.
Myriam Quémener est magistrat, docteur en droit, est actuellement avocat général près la Cour d'appel de Paris après avoir été conseiller juridique sur les questions de cybercriminalité au ministère de l'Intérieur.
Clément Wierre est avocat au barreau de Paris et exerce au sein du cabinet Peltier Juvigny Marpeau & Associés. Il enseigne le droit du numérique à Sciences Po Paris.
::: CRISE : QUELLE SOLIDARITE DANS LE MONDE DES AFFAIRES ?
Dans cette période incertaine, de quelle manière peut intervenir le droit et la justice ? A l’instar de l’initiative des tiers conciliateurs pour faciliter la résolution des litiges, la solidarité pourrait-elle faciliter la reprise et de manière générale la vie des affaires ? Dans une relation d’affaires, la solidarité pourrait-elle s’organiser de manière contractuelle ?
::: LA SOLIDARITE : TOUS INTERDEPENDANTS par Paul-Louis NETTER

La solidarité juridique
En matière juridique la solidarité est un concept extrêmement fort puisqu’il implique une communauté d’engagement. Ainsi s’obliger solidairement à faire quelque chose ou à payer une certaine somme veut dire que l’un ou l’autre des acteurs concernés peut être amené à exécuter la totalité de ce à quoi chacun s’est engagé. La conséquence éventuelle de cette solidarité amène à considérer avec beaucoup de circonspection ce type d’engagement.
La solidarité économique
Elle peut s’exprimer de deux façons. La solidarité qui résulte du processus de fabrication est la conséquence de l’application du concept de spécialisation efficiente : je fabrique ce que je sais le mieux fabriquer. Ce faisant, en renonçant à produire l’intégralité des composants entrant dans une fabrication, ou, de façon plus large, des biens de consommation, je dépends des autres fournisseurs pour mener cette fabrication à son terme ou m’approvisionner en biens que je ne produis pas (ou plus).
L’autre approche est celle de la solidarité des acteurs économiques, à la fois acheteurs et fournisseurs. Point n’est besoin de développer les conséquences d’un défaut de paiement qui, par suite de cette imbrication d’intérêts, peut se répercuter en chaîne. Autrement dit, il y a une vraie solidarité dans le monde des affaires mais pas au sens « d’aide ».
La notion d’intérêt social
On peut se demander si la notion de solidarité qui implique l’idée d’un geste ou d’une action sans attente d’une récompense ou compensation de quelque nature qu’elle soit, est possible, à l’exception de cas expressément prévus, comme le mécénat. En effet, l’action de l’entreprise est gouvernée à la fois par son objet social et son intérêt social. Au-delà des questions récentes touchant à l’extension de l’objet de l’entreprise (raison d’être…) la notion d’intérêt social ne semble pas lui laisser une grande marge puisqu’elle implique que tout acte soit accompli dans cette perspective. Le négatif de ce concept réside dans l’idée bien établie d’abus, consistant en l’utilisation des biens de l’entreprise à des fins étrangères à son objet ou son intérêt.
Les tiers conciliateurs
Cette initiative, née au sein de l’association Paris Place de Droit, part de l’idée que la crise sanitaire va placer de nombreux acteurs économiques dans une situation juridique difficile. Ainsi des conflits peuvent naître entre deux personnes de bonne foi placées dans des positions opposées par suite de contraintes extérieures. La communauté du droit au travers de nombre de ses acteurs (avocats, juristes d’entreprise, universitaires, juges conciliateurs...) a alors contribué à la mise en place d’une plateforme permettant par exemple à deux entreprises de saisir conjointement un tiers conciliateur qui s’efforcera de faciliter la résolution de leur différend en dehors des voies procédurales et judiciaires classiques. Le recours à cette formule ne coûte qu’une part de ses frais de fonctionnement. Autrement dit, il s’agit bien là d’un geste de solidarité exercé par des acteurs à titre bénévole, en dehors de toute cadre entrepreneurial, c’est-à-dire hors des contraintes rappelées ci-dessus.
Paul-Louis NETTER,
président,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
::: LA SOLIDARITE, UN ANGLE MORT DU DROIT DES AFFAIRES par Frédéric MANIN

La solidarité possède de multiples visages. Elle s’exprime naturellement dans la sphère sociale mais elle est ou est devenue également écologique, intergénérationnelle, géopolitique ou consubstantielle de l’apport redécouvert de métiers en particulier à l’effort national. Il ne fait pas de doute que la crise sanitaire actuelle et les transformations qui la suivront donneront au principe un relief particulier.
Voici maintenant que, dans un domaine aussi aride (mais essentiel) que celui des délais de paiement inter-entreprises, le comité de crise mis en place sous l’égide du ministre de l’Economie et des Finances et du gouverneur de la Banque de France, en appelle, d’un communiqué à un autre, au respect de la « solidarité économique » et donne en exemple des entreprises solidaires, en identifiant, par ailleurs, des pratiques anormales.
La solidarité n’est assurément pas une idée neuve dans le monde des affaires. Elle se situe au cœur de la stratégie ou de l’image de la plupart des grandes entreprises. De plus, l’économie dite sociale et solidaire (ESS) représenterait près de 10% du PIB et pas loin de 13% des emplois privés en France.
La solidarité a, dès lors, pu inspirer des notions ayant progressivement trouvé leur place au sein de la réglementation régissant les relations commerciales. Une relation d’affaires peut ainsi être déséquilibrée, si tant est que le déséquilibre en question n’est pas significatif. Une entente de caractère anticoncurrentiel peut être licite dès lors qu’elle est efficacement justifiée par la réalisation du progrès économique, lequel progrès étant susceptible de s’exprimer à travers « la création ou le maintien d’emplois ». D’autres illustrations pourraient aisément être trouvées.
Reste que le principe ne dispose pas de socle normatif clair. Il ne constitue pas une direction affirmée et valorisée, à l’exception, tout de même, du champ ouvert par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS. On a même vu dans d’autres forums s’édifier un « délit de solidarité », avant que le Conseil constitutionnel n’y mette bon ordre, par sa décision du 6 juillet 2018 déclarant contraires à la Constitution certaines dispositions législatives, au nom du principe, très voisin, de fraternité. La tentation peut, dans ces conditions, être grande de faire de cette valeur un angle mort du droit des affaires, ou une variable d’ajustement, pour aboutir à ce que des solutions judiciaires ou administratives différentes soient atteintes dans des cas a priori semblables. La solidarité serait alors ferment d’insécurité juridique.
Il fut un temps où un principe, celui de précaution, faisait son apparition dans le bloc constitutionnel français, en soulevant probablement autant de problèmes qu’il n’apportait de solutions. Le principe de solidarité doit-il aiguillonner les réflexions des juristes de demain, qu’ils soient experts du droit des entreprises ou familiers des questions de droit de l’homme ? La convergence d’approche et de politique d’un univers à un autre, que les principes affirmés par la CEDH ont d’ores et déjà permis d’instituer, connaîtrait alors un nouveau rebond
Frédéric MANIN,
avocat associé,
ALTANA
::: UN LIVRE INSPIRANT : ETHIQUE DES AFFAIRES, POUR UNE GOUVERNANCE INTEGRE
L’éthique des affaires ne se décrète pas mais s’organise dans l’entreprise autour des bonnes pratiques. Le risque de réputation peut mettre à genoux une entreprise. Pour modifier les comportements, il est indispensable que la Gouvernance se saisisse du sujet pour le faire sien.
L’objectif n’est pas de devenir une entreprise vertueuse mais une entreprise alignée entre les valeurs défendues et les comportements observés sur le terrain. Pour atteindre cet objectif ambitieux, chaque collaborateur, administrateur, dirigeant doit être en mesure de développer les bons réflexes au moment de prendre une décision. L’éthique des affaires est donc avant tout un enjeu de culture. C.D
Cédric Duchatelle est directeur groupe conformité & éthique des affaires d’AG2R LA MONDIALE. Ancien avocat, il enseigne également à l’Ecole Supérieure de la Banque et préside le pôle entreprise & recherches du Cercle d’Ethique des Affaires. L’éthique des affaires, pour une gouvernance intègre est son premier ouvrage.
BBB
::: REPRISE VERTE ET ETHIQUE : COMMENT LE DROIT PEUT-IL PALLIER LES INSUFFISANCES DE LA LOI DU MARCHE ?
5 000 milliards de dollars d’actifs ! C’est le poids des fonds d’investissements demandant aux Etats d’accroître de manière contraignante le devoir de vigilance à travers le monde, notamment pour protéger les travailleurs. A travers cet appel aux instances étatiques, les fonds d’investissements enjoignent également les entreprises à modifier leurs comportements.
Du côté des pouvoirs publics, huit autorités de régulations françaises dont l’Autorité de la Concurrence et l'Autorité des marchés financiers s'engagent, dans un communiqué commun, à faire de l'urgence climatique leur priorité. Les dirigeants d’entreprises, soutenus par l’AFEP et le MEDEF, appellent eux aussi à une relance plus respectueuse de l’environnement. Une multitude d’acteurs prône ainsi une reprise plus éthique, plus verte, pour une économie plus responsable. A leurs côtés, comment les juristes peuvent-ils l’accompagner ? Quelles interactions favoriser entre les autorités et les entreprises dans la recherche d’une économie performante et plus vertueuse ?
::: L’AMF ENTEND FAVORISER LA TRANSITION VERTE : QUELS ENJEUX POUR LES ENTREPRISES ? par Benoît de JUVIGNY et Benjamin DRIGHES

En s’exprimant sur l’urgence climatique avec sept autres autorités françaises de régulation, l’AMF a souhaité mettre en évidence les transformations profondes qu’implique l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris pour les activités qu’elle régule et témoigner d’une volonté commune d’agir pour préparer les transformations à venir, dans le cadre des mandats confiés par le législateur français ou européen. En l’occurrence, les marchés financiers ont un rôle déterminant à jouer dans la réorientation des capitaux au profit de la transition verte. Dans ce contexte de crise, les besoins d’investissement, considérables, pourraient être renforcés alors que de nombreux appels sont lancés pour que le développement durable soit au cœur de la reprise économique.
L’industrie financière se mobilise de plus en plus, en travaillant à de nouvelles méthodes pour intégrer les risques climatiques et en développant des produits financiers plus « verts ». Mais les défis sont nombreux et c’est l’ensemble de la chaîne financière qui doit être repensée. C’est l’objectif du plan d’action pour la finance durable de la Commission européenne qui vient d’aboutir notamment, à la définition d’une taxonomie des activités durables et va imposer de nouvelles obligations de transparence aux gérants d’actifs et aux investisseurs sur la prise en compte des risques environnementaux et sociaux et sur les impacts négatifs sur l’environnement des investissements.
En amont, la qualité de l’information extra-financière fournie par les sociétés est indispensable aux décisions des investisseurs et à la mise en œuvre de leur politique d’engagement. L’AMF a explicité, dans son dernier rapport sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées, les enjeux des nouvelles « déclarations de performance extra-financière » issues de la directive 2014/95/UE. La révision prochaine de cette directive est une opportunité pour renforcer la robustesse de ces informations et développer des standards européens permettant une meilleure comparabilité de l’information.
En fin d’année, l’AMF publiera aussi avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport sur le suivi et l’évaluation des engagements du secteur financier en matière de climat. Si les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire continuent à mobiliser l’attention, elles ne doivent pas faire oublier celles à venir de la crise climatique. C’est un enjeu clé pour le régulateur.
Benoît de JUVIGNY, secrétaire général,
Benjamin DRIGHES, conseiller stratégie,
Autorité des Marchés Financiers
::: METTONS ENFIN LA FINANCE AU SERVICE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE : QUELLES REVISIONS POUR " SOLVABILITE II " ? par Pascal DEMURGER

L’Eiopa, l’autorité européenne de régulation des assureurs, a annoncé le report à décembre de ses conclusions sur l’évolution du cadre prudentiel de « Solvabilité II », afin de prendre en compte « l’impact de la pandémie sur les marchés financiers et les activités d’assurance ». Entrée en application en 2016, cette directive impose notamment aux assureurs de disposer d’un certain montant de fonds propres pour faire face à d’éventuelles situations exceptionnelles. Mais ce cadre réglementaire a aussi pour conséquence d’influencer durablement leurs investissements, en exigeant plus ou moins de fonds propres en fonction de la nature de ces investissements et de leur risque intrinsèque.
Lors de l’adoption de la Directive, les assureurs s’étaient élevés contre l’injonction paradoxale de la puissance publique, qui souhaite qu’ils financent l’économie grâce à leurs investissements mais qui pénalise l’investissement en actions par des exigences en fonds propres jugées par certains excessives. Nombreux sont ceux qui voudraient rouvrir ce débat aujourd’hui.
En réclamant simplement un allègement du coût de la détention d’actions, le monde de l’assurance s’apprête à mener la même bataille qu’il y a 15 ans, sans s’apercevoir qu’entre-temps le monde a changé. Si les règles prudentielles devaient être modifiées par l’Union Européenne pour mieux orienter les investissements, elles devraient avoir pour objectif prioritaire de financer la transition écologique. C’est une question de responsabilité envers les générations futures, c’est, aussi, une question de performance économique à long terme.
Et les enjeux sont gigantesques : les investissements des assureurs français représentent la somme colossale de 2 500 milliards d’euros, soit sept fois plus que le budget de l’État. Imaginons que seulement 1% de ces investissements soit affecté à la transition écologique : ce seraient 25 milliards d’euros supplémentaires alloués au financement d’une économie plus vertueuse.
La révision de la directive « Solvabilité II » nous offre l’opportunité de mettre la finance davantage au service de la transition écologique. Saisissons-la.
Pascal DEMURGER, directeur général,
GROUPE MAIF
::: LE DROIT : UN INDISPENSABLE A LA REPRISE VERTE par Yvon MARTINET

Alors que la crise du Covid-19 met brutalement toute notre société à l’arrêt, beaucoup d’entreprises ont saisi cette occasion pour tourner la page du « business as usual » et amorcer la transition vers une économie plus sobre et écologiquement responsable. Dans ce contexte, le droit est plus que jamais un instrument crucial, à la fois support et accélérateur de cette transition.
Support, parce que les évolutions récentes du cadre juridique offrent maintenant une structure d’appui nécessaire à l’ancrage des évolutions envisagées. Les récentes dispositions issues de la loi Économie Circulaire de février 2020 en matière de plastique à usage unique prennent un éclairage nouveau face à l’explosion du plastique utilisé depuis le début de la crise sanitaire. Les possibilités offertes aux entreprises en matière de RSE depuis la loi Pacte, votée il y a tout juste un an, sont à présent utilisées par certains grands groupes pour engager leur transformation (comme le géant de l’alimentaire Danone qui a annoncé sa volonté de devenir « société à mission » en plein cœur de la pandémie).
Mais aussi accélérateur, en ce que le droit est un vecteur de valeurs qui structure l’économie de demain. Il suffit de voir par exemple la subordination dans la loi de finances rectificative pour 2020 des aides économiques de l’État au respect, par les entreprises, de considérations environnementales, ou, au niveau communautaire, l’ambitieux Green New Deal de la Commission européenne. C’est par le droit que passe cette transition vers une économie plus sobre et responsable, et les entreprises sont parfaitement conscientes de la puissance de cet outil. Loin de l’image d’un droit punitif poussant les acteurs économiques à s’engager malgré eux dans cette transition, une coalition de 163 PDG de grandes entreprises a récemment demandé l’intégration d’objectifs climatiques dans les plans de relance post-Covid. Face à l’exigence de repenser notre économie et son rapport à l’environnement, le droit est un levier incontournable.
Yvon MARTINET, avocat associé,
DS AVOCATS
::: UN LIVRE INSPIRANT : LE TEMPS RETROUVE DE L’ECONOMIE
Les désordres qui naissent de l’instabilité intrinsèque des économies de marché, requièrent de maîtriser leurs temporalités multiples grâce à des entreprises conçues comme des coalitions dont les parties prenantes ont à concilier leurs investissements respectifs, des banques et des marchés financiers organisés pour s’assurer d’un capital patient, des emplois solides garants de la capacité d’apprentissage des salariés, des États qui choisissent de compenser les déséquilibres d’une période à l’autre et décident des dispositions institutionnelles validant les connexions de marché nécessaires. J-LG.
Jean-Luc Gaffard, professeur émérite d’économie Université Côte d’Azur, OFCE Sciences Po, SKEMA Business School, et Institut Universitaire de France, Mario Amendola, professeur émérite d’économie, Université de Rome La Sapienza, Francesco Saraceno, chercheur Senior à l’OFCE Sciences Po, professeur à Sciences Po et la LUISS Guido Carli de Rome.
::: TECHNOLOGIES : LE COVID-19 IMPOSE UN NOUVEAU REGARD
La CNIL donne son feu vert à Stop Covid-19 et nous avons tous en tête « 1984 » (le roman de G. Orwell). La technologie est au service de la justice et la justice gardienne des potentiels dérives technologiques. Les acteurs économiques recourent largement aux technologies. Qu’en est-il des acteurs du droit et de la justice ?
Stéphane Noël, président du tribunal de Paris, déclare le 13 mai 2020, « Arrêtons les réformes, modernisons la justice (…) Lors du confinement, nous avons vécu un collapsus organisationnel à cause de l’informatique. Il ne sert à rien de multiplier les réformes législatives qui se succèdent à un rythme effréné sans application informatique corrélée et sans test préalable. » Parallèlement, Predicitice constate que les juristes ont de plus en plus apprivoisé leur outil de recherche et désormais l'outil de « justice prédictive ». Ce dernier est une aide à la décision pour évaluer les chances de succès d’une affaire.
La justice de demain sera résolument technologique, n’est-ce pas à nous de lui donner un visage humain ?
::: COVID 19 : L'ACCELERATEUR D'UNE JUSTICE DIGITALISEE par Louis LARRET-CHAHINE et Elise MAILLOT

Les professions juridiques n’ont pas attendu la crise du Covid-19 pour entamer leur profonde mutation : celle de leur digitalisation, qui passe avant tout par la numérisation de leurs outils de travail.
Cette digitalisation a toujours été portée par deux tendances, qui n'ont pas disparu avec la crise sanitaire et le confinement : d'une part, l'explosion de l'information juridique (ce qu'on appelle souvent le "big data" juridique) ; d'autre part, le besoin de travailler avec des outils ergonomiques, performants, accessibles partout et à tout moment. Cette double tendance entraîne un effet de ciseau puissant sur les pratiques traditionnelles (par exemple, consulter l'information juridique dans un code papier) et conduit les professionnels du droit à repenser leur façon de travailler.
A défaut de révolutionner ce processus déjà bien en marche, la crise que nous traversons entraîne son accélération. En effet, les professions juridiques ont subi de plein fouet l’interruption quasi-totale de l’activité judiciaire et économique. Certains cabinets d’avocats ont été contraints de cesser leur activité, tandis que d'autres ont vu leur activité chuter, entraînant mécaniquement des difficultés majeures de facturation. Dans ce contexte, ceux qui réfléchissaient encore à l'intérêt de digitaliser leur activité ont été contraints de recourir massivement à de nouveaux outils, de façon à optimiser le travail à distance. En particulier, les solutions SaaS comme Predictice se sont révélées incontournables : en utilisant très simplement un couple identifiant/mot de passe, les utilisateurs peuvent se connecter partout de façon sécurisée et accéder à l'intégralité des fonctionnalités de l’outil, exactement comme sur leur lieu de travail. Nous avons à cet égard constaté une forte hausse des demandes de test sur notre plateforme depuis le début de la crise.
Depuis la création de Predictice, nous observons que les professions juridiques s’adaptent très bien à la digitalisation du monde du droit : la crise du Covid-19 ne fait que confirmer notre constat. Les réticences qui perdurent sont marginales et fondées sur la crainte du remplacement de l’Homme par la machine, qui n’est qu’un mythe : loin d’être rendues inutiles par les nouveaux outils mis à leur disposition, ces professions peuvent au contraire se recentrer sur des tâches qui ont davantage de valeur ajoutée pour leurs clients. Les plus résilients seront les grands gagnants de la sortie de crise !
Louis LARRET CHAHINE, Elise MAILLOT
cofondateur, responsable des relations publiques,
PREDICTICE
::: STOP COVID-19 - L'APPLI QUI TRACE LE VIRUS. DE QUOI AVONS-NOUS PEUR ? par Jean-Guy de RUFFRAY
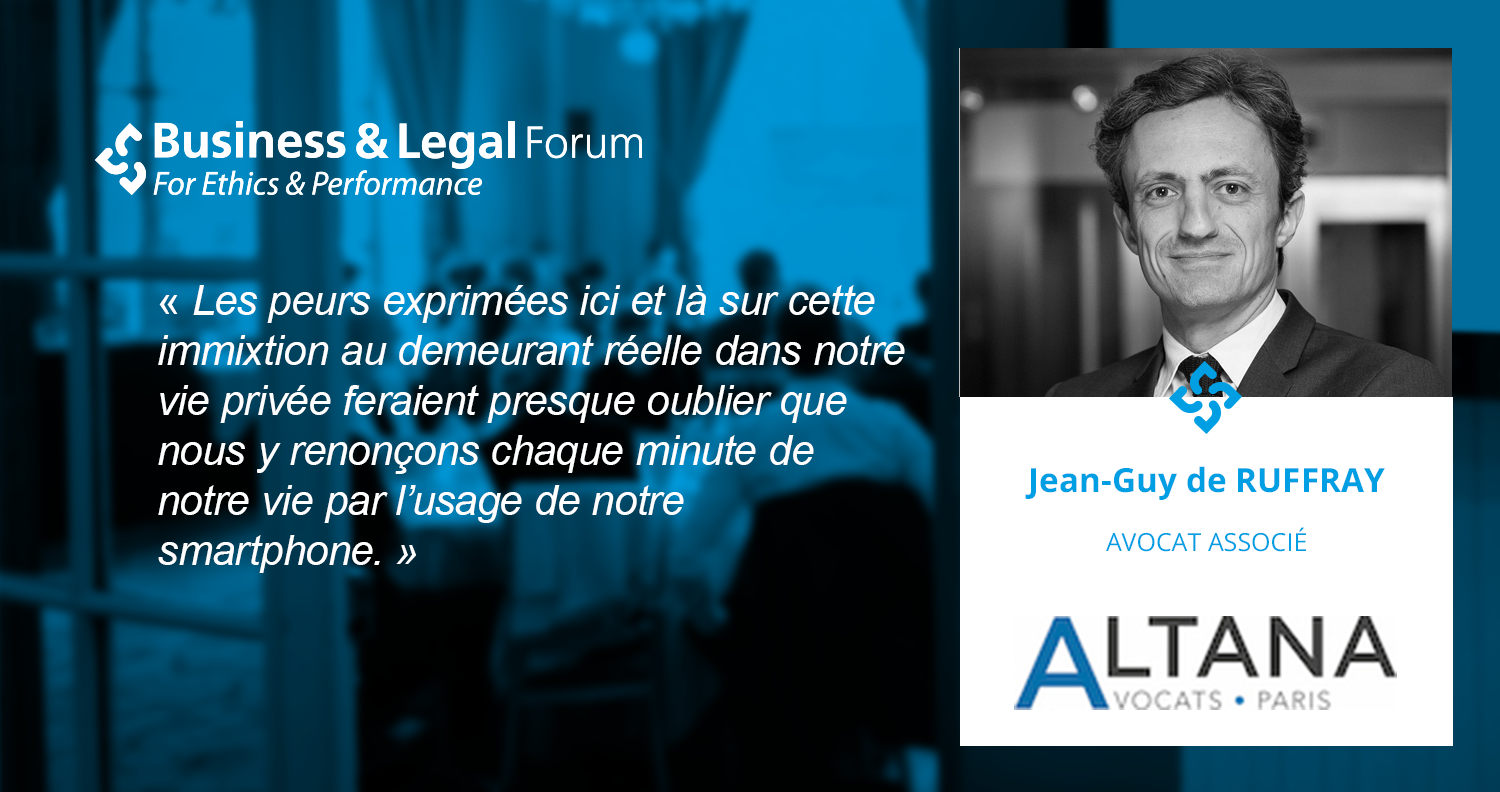
Il est fort à parier que le même virus, survenu en d’autres temps où les sociétés n’étaient pas encore des sociétés de l’information, aurait fait des ravages bien plus importants, en particulier en termes sanitaires. Ce qui a permis aujourd’hui d’amoindrir les conséquences de cette crise sanitaire, c’est essentiellement l’accès et la transmission de l’information : données médicales partagées au niveau mondial, stratégies de confinement et de déconfinement inspirées d’autres Etats grâce aux informations accessibles en temps réel, etc.
Ce qui aura permis à certaines professions de continuer de fonctionner pendant le confinement, ce sont encore les technologies de l’information. On lit ici et là que la crise que nous traversons devrait être l’occasion idéale de remettre en cause la façon de fonctionner de nos sociétés. C’est probablement vrai, à une exception notable : la révolution numérique est plus que jamais notre refuge premier.
Dans ces conditions, il était prévisible que l’homme cherche dans le nouvel or noir que sont les données, la solution à une situation prétendument inédite. Prétendument, car en réalité son caractère inédit n’est dû qu’à la réponse quasi-homogène et presque concertée des Etats, qui ont comme un seul homme opté pour une solution dont personne ne sait comment sortir rationnellement : le confinement. La Corée du Sud, la première, a eu recours à une application permettant, par un traçage des déplacements et des personnes rencontrées, d’accompagner la population vers un retour à une vie normale. Il était prévisible que d’autres Etats s’intéressent à cette solution, et que de tels outils suscitent des inquiétudes quant au respect des libertés publiques, de la vie privée, et de toutes les valeurs qui font le socle des démocraties occidentales empreintes de libre arbitre mais aussi d’individualisme.
Or, la société est forte par le groupe. En temps de pandémie, l’autre est à la fois votre pire danger, et malgré tout votre secours, puisqu’il n’est de solutions que collectives. Le temps est donc venu de raisonner collectivement, en oubliant temporairement notre individualisme ; et nous autres européens, avons un garde-fou matérialisé par la réglementation sur les données personnelles la plus contraignante qui soit. Mille critiques peuvent être formulées sur le RGPD, et ce n’est pas le lieu de le faire. Mais pour une fois qu’il peut vraiment servir à rassurer la population sur le recours à des moyens de contrôle temporaires qui n’auraient pour seule visée que de nous aider à retrouver une vie normale et plus encore sauver des vies, autant lui rendre hommage.
La CNIL vient de donner son blanc-seing à l’application Stop Covid-19, laquelle permettra à chaque français qui le souhaite de garder la trace des autres utilisateurs croisés pendant les deux semaines précédentes, à moins d’un mètre et pendant au moins 15 minutes. Pas de géolocalisation, mais un fonctionnement basé sur le Bluetooth des smartphones qui leur permet de « communiquer » entre eux. Les réserves exprimées par la CNIL, notamment quant à l’information des utilisateurs et les modalités d’effacement des données personnelles, sont classiques et non bloquantes, puisqu’elles concernent des aspects améliorables du dispositif.
L’application Stop Covid-19 va donc voir le jour, et son utilité dépendra essentiellement de l’adhésion du plus grand nombre. Et, bien sûr, au postulat que d’un point de vue technique ce qui est mis en place est fiable et efficace, ce qui est probablement l’enjeu majeur.
Les peurs exprimées ici et là sur cette immixtion au demeurant réelle dans notre vie privée feraient presque oublier que nous y renonçons chaque minute de notre vie par l’usage de notre smartphone ou lors d’une navigation sur Internet. Combien de renoncements à notre vie privée faisons-nous chaque jour en échange de services gratuits sur Internet ? Combien de politiques de confidentialité validées chaque jour totalement à l’aveugle, au bénéfice de sociétés privées mues par des intérêts commerciaux et non par ceux, supérieurs, de l’intérêt général, de la santé publique et de l’Etat ? Doit-on vraiment faire plus confiance à une société privée, souvent étrangère, pour lui partager nos données de géolocalisation, au prétexte qu’elle nous permet d’accéder à tel ou tel gadget numérique qui nous permettra quelques instants de gloire sociale sur les réseaux sociaux ?
En d’autres contrées, ce type d’outils peut en effet faire froid dans le dos, tant le système politique et juridique qui les encadre est sujet à caution. Ce n’est pas le cas de la France, à date.
Jean-Guy de RUFFRAY,
avocat associé,
ALTANA
::: UN LIVRE INSPIRANT : COLLAPSUS. CHANGER OU DISPARAITRE ? Le vrai bilan de notre planète.
Dans les rayons des libraires, Laurent Aillet, consultant, et Laurent Testot, journaliste, voyaient se multiplier les prédictions sur le futur. Chaque essai partait d’un avenir jugé idéal et expliquait comment y arriver. Or tous deux estiment que pour imaginer des futurs plausibles, il faut commencer par analyser le présent, en décryptant sa complexité.
Collapsus est né de cette démarche : ils ont sollicité 40 experts de toutes disciplines, des militants et des journalistes, pour dresser un état des lieux de la Terre, de ses ressources, des tendances de l’humanité ; analyser les dynamiques à l’œuvre ; et diagnostiquer des évolutions possibles. Cet ouvrage, publié juste avant la crise de la Covid-19, est prémonitoire : en fournissant au grand public un panorama planétaire du spectre des futurs possibles, il vise à l’émanciper de tous ceux qui ambitionnent de contrôler l’avenir, en imposant leur récit du « monde d’après ». Leur conclusion à l’issue de cette enquête : si le futur n’est jamais écrit, mieux vaut être outillé pour éviter de se le faire dicter. L.A L.T
Laurent Aillet est consultant en résilience, expert en risques industriels. Laurent Testot est journaliste scientifique, écrivain et formateur.
::: PETITS ESSAIS PROSPECTIFS : LE DROIT ET SES PRATICIENS APRES LE COVID-19- partie 3
Lors de la crise économique de 2008, le Business and Legal Forum demandait à Christine Lagarde, alors ministre de l’économie : « le droit est-il le maillon faible de l’économie ? ».
Nous vivons actuellement une crise différente, celle sanitaire liée au COVID 19. Cette crise balaye notre organisation du travail traditionnelle et bouleverse notre quotidien. « Le propre d’une crise c’est de faire émerger un élément de nouveauté inattendu » énonçait Hannah Arendt. Quelles perspectives cette crise met-elle alors en exergue ? Ne nous permet-elle pas de repenser l’articulation du droit et de l’économie, ainsi que le rôle joué par les acteurs de ces deux domaines structurants de notre société ? L’économiste Thomas Piketty nous interroge sur la transformation de notre système économique, en soulignant qu’il « ne suffit pas de dire qu’il faut changer ce système, mais qu’il faut décrire quel autre système économique, avec quelles autres organisations de la propriété et quels autres critères de décision. Il faut remplacer le PIB et sa maximisation par d’autres notions. »
Amis juristes, souvent pompiers pour éteindre l’incendie, et si vous preniez la parole pour un essai prospectif sur l’organisation d’un autre système économique. Le droit n’est-il pas le garant d’un système économique vertueux ?
::: LE DROIT, ACCELERATEUR DE SORTIE DE CRISE SI... par Marc MOSSE
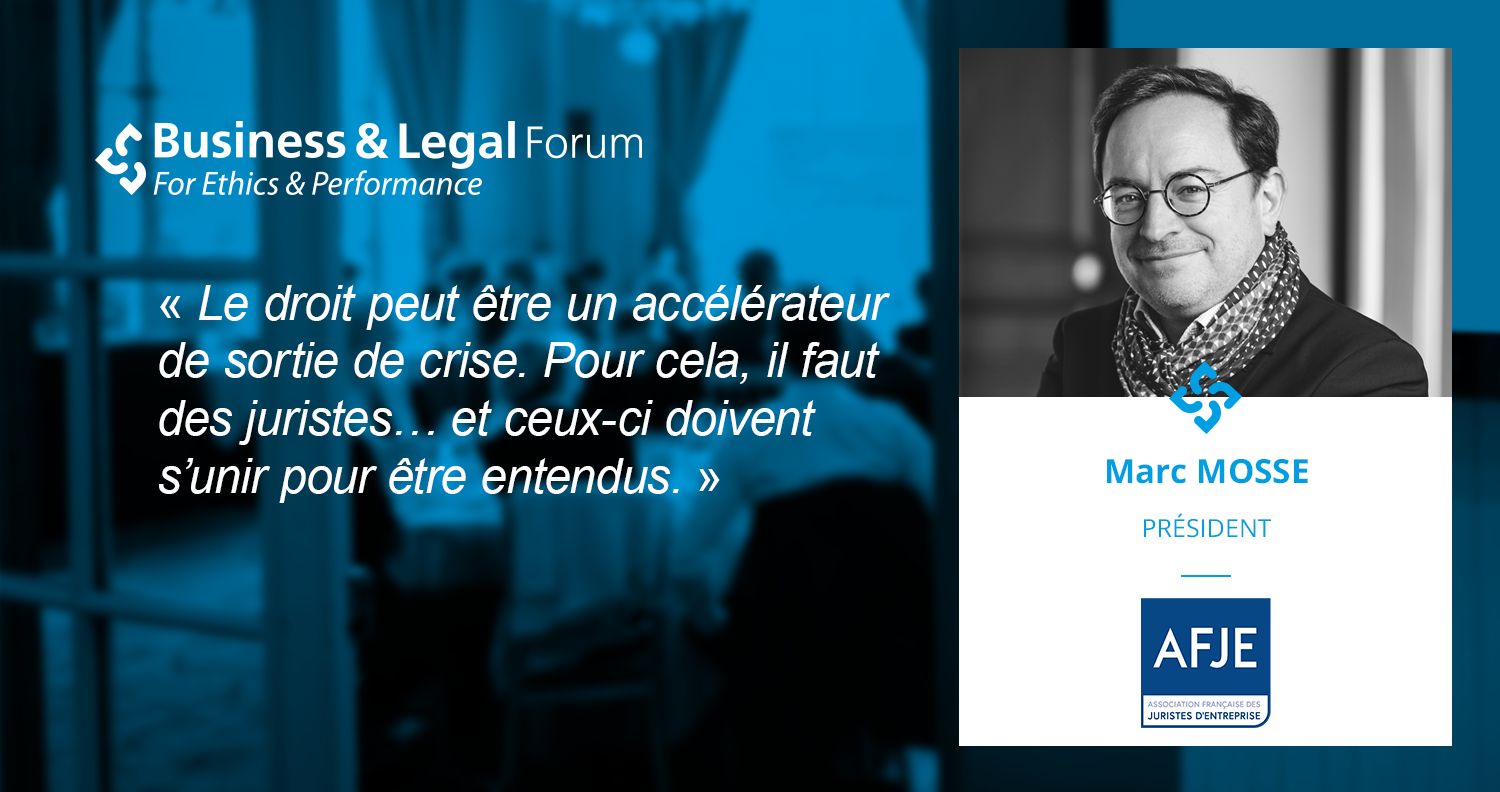
Les crises sont littéralement des moments de choix. Celle que nous connaissons aujourd’hui exige à la fois des réponses immédiates et des décisions structurantes. Pour les unes comme pour les autres, il est certain que le droit et ses acteurs sont en première ligne.
Le droit peut être un accélérateur de sortie de crise. Pour cela, il faut des juristes… et ceux-ci doivent s’unir pour être entendus.
D’abord, comme chacun le redoute, l’impact économique de la pandémie sera immense. De nombreuses entreprises, dont beaucoup de TPE et PME, seront frappées. Dès lors, il est à craindre que les contentieux se multiplient, et il faut prévoir que l’institution judiciaire, prise dans toutes ses composantes, puisse y répondre. Le service public de la justice est fondamental et il importe, à cet instant, de lui donner tous les moyens nécessaires d’agir. Sans doute faudra-t-il aussi que des réponses innovantes apparaissent sans attendre ! Les acteurs du droit doivent alors répondre présents et, à cet égard, « Paris Place de Droit », regroupement de femmes et d’hommes de droit, œuvre d’ores et déjà à l’invention de formes originales et adaptées pour traiter les besoins des entreprises aux prises avec certains effets de la crise. La Tierce-Conciliation, lancée le 19 mai, est un dispositif extra-judiciaire d’urgence et de conciliation exclusivement dédiée aux entreprises exposées à des difficultés générées par les effets du Covid-19. Grâce à la mise à disposition d’une plateforme digitale collaborative, les entreprises pourront bénéficier gratuitement de la mise en place d’espaces temporaires de négociation.
Ensuite, c’est-à-dire déjà maintenant, il nous faut collectivement imaginer le rôle que le droit peut jouer afin de bâtir un futur durable. Le moment n’est pas aux prophètes de malheur, épigones du Philippulus de l’Etoile Mystérieuse annonçant la fin des temps pour châtiment divin. Bien au contraire, il s’agit de placer le droit au centre des outils indispensables pour construire une société durable.
Les crises sont aussi des accélérateurs de changement. La dimension planétaire de cette pandémie, rend plus évidente encore la crise du multilatéralisme, les faiblesses de l’Europe, les dangers qui menacent les démocraties libérales, et la facilité avec laquelle certaines libertés individuelles et publiques semblent pouvoir être méconnues. Une nouvelle géopolitique s’affirme et le droit doit être au cœur de ces évolutions. C’est une nécessité impérieuse. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des lois et des réglementations. Nous n’en manquons pas et il est bon de se rappeler, encore une fois, que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. En revanche, dans un pays à la tradition de légicentrisme si prégnante, il importe de penser le droit comme un atout stratégique en soi. C’est une urgence si l’on considère l’accélération des transformations souvent irréversibles portées, notamment, par le numérique.
Le temps d’une véritable politique publique de développement du droit, tant au niveau national qu’européen, est venu.
La compétitivité de nos économies, la capacité d’innovation de nos entreprises, l’efficacité de l’Etat et de nos services publics peuvent largement s’adosser à un droit qui soit à la fois puissant et facilitateur. Il importe ainsi de concevoir une véritable filière au service d’un intérêt supérieur : l’Etat de droit. Pour y parvenir, encore faut-il s’en donner les moyens. Aussi, convient-il de remettre en perspective la nécessité d’une profession du droit enfin rassemblée et d’en définir le périmètre et ses caractéristiques. Seule une convergence intelligente des avocats et des juristes d’entreprise permettra de répondre aux enjeux immenses qui s’annoncent. L’AFJE, l’ENM, l’EFB et l’IHEJ, en s’associant pour créer la formation MAJ, première formation rassemblant avocats, magistrats et juristes d’entreprise, ont montré la voie. Anticiper les mutations suppose de valoriser le statut des professionnels du droit face aux ruptures technologiques. Cette communauté des juristes, véritable filière à part entière, forte de sa déontologie et de la protection idoine de la confidentialité et du secret professionnel, pourra ainsi répondre aux défis d’une complexité accrue de la globalisation sous la menace d’un risque de dangereuse fragmentation. Ainsi, les juristes auront la possibilité d’influer en amont sur la multiplication des programmes de conformité dans un environnement où l’hybridation des systèmes juridiques et l’extraterritorialité ne cessent de questionner les Etats. L’AFJE forte de son implantation sur l’ensemble du territoire, y compris outre-mer, mesure combien ces questions ne sont pas des préoccupations germanopratines dès lors que 84 % de ses juristes travaillent avec l’international. Cet engagement pour une prise en compte des questions de gouvernance et de nouvelles régulations dans une mondialisation en proie à certaines tentations, a conduit l’AFJE à rejoindre l’Appel de Paris pour la confiance dans le cyberespace dans le cadre du Forum de Paris pour la Paix. La même logique doit prévaloir pour que les juristes se mobilisent pour être au premier rang afin de rendre possible le Green Deal que les générations futures exigent. Les initiatives multi-partie prenantes sont parmi les nouvelles voies que les juristes peuvent emprunter pour rester des créateurs de droit et sortir du champ limité où ils ont été trop longtemps confinés.
Dans des sociétés en quête de confiance, les juristes au service du droit et de l’intérêt général peuvent être des acteurs du changement, des passeurs d’avenir.
Marc MOSSE,
président,
Association Française des Juristes d’Entreprise - AFJE
::: DU SENS, DES TALENTS, UN MANAGEMENT ET DES OUTILS, par Christophe ROQUILLY

L’après Covid19, avec l’incertitude liée à la menace rampante du virus, ne sera confortable pour personne. Dans ce contexte, les juristes – quelle que soit la forme d’exercice de leur métier – seront plus que jamais les « anges gardiens » de l’entreprise. Au côté des clients ou des autres équipes au sein de l’entreprise, leur rôle de sécurisation juridique des actions et des projets actuels et futurs sera déterminant. La période que nous traversons, et ses conséquences durables, appellent les équipes juridiques à être pleinement conscientes de quatre dimensions constituant les piliers de leur performance.
Du sens
Chaque direction juridique, chaque cabinet d’avocats (sans oublier les autres professions réglementées du droit) doit s’interroger sur sa raison d’être. Tenant compte des clients ou de l’entreprise qu’il est censé servir, comment incarne-t-il sa vision et son ambition, en se définissant d’abord par ce qu’il est, avant de savoir ce qu’il doit faire. Cette raison d’être constitue le socle de sa stratégie devant le conduire à des actions dont les objectifs sont mesurables. Puisque le cœur de métier du juriste est de gérer l’incertitude juridique (ou l’incertitude économique par des solutions juridiques), il a besoin d’une boussole ou d’un phare qui éclaire le cap à suivre. Pour les directions juridiques ne l’ayant pas encore fait, cette période est propice à la définition de leur raison d’être. Pour les cabinets d’avocats ou tout prestataire externe de solutions juridiques au bénéfice de leurs clients, la vision doit s’accompagner d’un modèle économique (ou d’un changement de modèle) leur permettant de faire face à la crise et de comprendre quels sont les maillons de leur chaîne de valeur. Parmi les ressources à mobiliser pour mener à bien leurs actions, les talents de leurs équipes vont jouer un rôle essentiel.
Des talents
Bien évidemment, la formalisation et la distribution de solutions juridiques au profit du client nécessitent un certain nombre de tâches répétitives, dont certaines vont être de plus en plus automatisées/digitalisées. Cependant - et nous avons tous pu le constater durant ces 8 semaines - le talent humain reste la meilleure arme fasse à l’adversité et l’incertitude. Etre agile, savoir s’adapter, anticiper, réagir vite et bien, innover quand une voie est bouchée, être à l’écoute, savoir s’entourer et savoir aider, sont autant de qualités que les équipes juridiques doivent conjuguer dans une logique d’intelligence collective. L’intelligence individuelle et singulière du juriste - celle d’un expert du droit - doit être combinée avec d’autres types d’intelligence. En augmentant ses compétences juridiques de compétences business, digitales et de « soft skills », le juriste donne la pleine mesure à son talent, puisqu’il comprend pleinement dans quel but son expertise est utilisée, quel est son impact, et quel rôle il joue au sein de l’équipe dont il enrichit l’intelligence globale.
Un management
La sortie du Covid19 - même si elle n’est que partielle - amène le management à tirer des enseignements. Le sens de l’écoute et de la pédagogie, la résistance au stress, la capacité à prendre de la hauteur, se découvrent ou se redécouvrent. L’importance de savoir travailler en mode-projet, en « task forces », où les lignes hiérarchiques traditionnelles sont transcendées et où chacun accepte de laisser ou de partager une part de son leadership, est perçue comme déterminante, voire cruciale. Le « dépassement de fonction », comme on le connait par exemple dans le football, où l’on demande à un attaquant de savoir-défendre (ou à un défenseur de savoir attaquer), s’apprend, se développe et se cultive. A chaque manager (directrice ou directeur juridique, associé(e)(e) de cabinet ou d’étude) de connaitre ses forces et ses faiblesses, ainsi que de son équipe, pour tirer profit de chaque talent et cartographier l’intelligence collective.
Des outils digitaux
Après deux mois de télétravail pour la plupart des équipes, le constat est assez clair : il faut continuer ou accélérer, selon les cas, la digitalisation de la direction juridique ou du cabinet. Travailler à distance, c’est finalement construire une intelligence collective grâce à une architecture d’outils digitaux qui permettent de gérer de la documentation juridique et des contrats, de développer de l’analyse de risques en vue de prendre une décision, de valider ensemble et par des moyens électroniques une solution juridique, de gérer l’écosystème de compétences et de talents. Face au digital nous ne sommes pas tous égaux : il faut se former et se faire accompagner ; également, le budget à y consacrer n’est pas le même selon les structures d’exercice. Pour que les équipes prennent confiance, il faut des « quick wins ». Pour que les outils permettent aux talents de s’exprimer et ne soient pas synonymes de dépenses inutiles, ils doivent impérativement s’inscrire dans la chaine de valeur de la direction juridique ou du cabinet, elle-même construite sur le socle de la raison d’être.
Le métier de juriste sera demain encore plus complexe et plus riche et partant, encore plus passionnant. A la communauté de le faire rayonner comme un elixir contre l’incertitude
Christophe ROQUILLY,
professeur,
doyen du corps professoral et de la recherche,
directeur de LegalEDHEC,
EDHEC Business School
::: FRED VARGAS, UNE REFLEXION PREDICTIVITE ?
"Nous y voilà nous y sommes", un texte écrit en 2008 par Fred VARGAS et lu par Charlotte GAINSBOURG. Un message fort, un raisonnement incisif sur l'avenir de notre planète, et un écho percutant sur notre période actuelle. Un thème clé qui résonne une nouvelle fois (et toujours avec autant d'acuité) dans son dernier ouvrage.
L’Humanité en péril, virons de bord, toute ! L'heure n'est plus à la remise en question de nos modes de vies et de consommation. Pour Fred VARGAS, nous sommes au bord de la rupture, il faut changer de cap. "Maintenant ou jamais" écrivait elle dejà en 2008. Ce livre, qui explore l'avenir de la planète et du monde vivant, souhaite mettre fin à la « désinformation dont nous sommes victimes » et enrayer le processus actuel.

Médiéviste et titulaire d'un doctorat d'histoire, Fred Vargas est écrivaine et chercheuse en Histoire et Archéologie au CNRS.
::: PETITS ESSAIS PROSPECTIFS : LE DROIT ET SES PRATICIENS APRES LE COVID-19- partie 2
Lors de la crise économique de 2008, le Business and Legal Forum demandait à Christine Lagarde, alors ministre de l’économie : « le droit est-il le maillon faible de l’économie ? ».
Nous vivons actuellement une crise différente, celle sanitaire liée au COVID 19. Cette crise balaye notre organisation du travail traditionnelle et bouleverse notre quotidien. « Le propre d’une crise c’est de faire émerger un élément de nouveauté inattendu » énonçait Hannah Arendt. Quelles perspectives cette crise met-elle alors en exergue ? Ne nous permet-elle pas de repenser l’articulation du droit et de l’économie, ainsi que le rôle joué par les acteurs de ces deux domaines structurants de notre société ? L’économiste Thomas Piketty nous interroge sur la transformation de notre système économique, en soulignant qu’il « ne suffit pas de dire qu’il faut changer ce système, mais qu’il faut décrire quel autre système économique, avec quelles autres organisations de la propriété et quels autres critères de décision. Il faut remplacer le PIB et sa maximisation par d’autres notions. »
Amis juristes, souvent pompiers pour éteindre l’incendie, et si vous preniez la parole pour un essai prospectif sur l’organisation d’un autre système économique. Le droit n’est-il pas le garant d’un système économique vertueux ?
::: QUAND LA VERTU CESSE D'ÊTRE UNE SIMPLE ASPIRATION MORALE , par Philippe PORTIER

Avant même que la crise sanitaire et économique en cours ne se ramifie en probable crise de valeurs, la question du rôle de l'avocat d'affaires se posait en matière d'éthique des affaires. En principe, le juriste n'a à se préoccuper que de la "règle de droit", savoir celle qui, indépendamment de toute considération morale, est posée par une autorité publique pour régir le comportement des agents économiques. Et qui est assortie d'une sanction sociale organisée – à l'opposé d'une règle éthique qui en est dénuée et ne regarde en principe que la conscience, ou encore de règles dites de "soft law", sans portée juridique coercitive. Mais cette conception stricte est désormais dépassée à raison de plusieurs facteurs.
En toile de fond, notre Société fait désormais jouer aux entreprises un rôle sociétal central. Là où il fallait naguère une loi pour doter une entreprise d'un rôle d'intérêt général (p. ex les institutions financières spécialisées de la loi bancaire de 1984), les acteurs économiques sont devenus des auxiliaires de la puissance publique dans la conduite de ses attributions les moins régaliennes. Ce n'est donc plus sur le seul terrain de ses performances économiques qu'une entreprise est désormais évaluée, mais de manière croissante sur sa capacité à assumer ses rôles et responsabilités sociétaux : favoriser l'emploi, compenser ses externalités négatives, modérer les rémunérations et les dividendes, lutter contre la corruption, universaliser notre conception occidentale des droits de l'homme ou nos normes sanitaires et sécuritaires… Et plus récemment participer à l'"effort de guerre" contre le coronavirus. Dans ce cadre, la règle de droit a évolué. L'intérêt social de nos entreprises doit désormais prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Par-delà les exigences de communication imposées à certaines sur leur "performance non financière" (environnementale, sociale, etc.), les articles L225-102-4 et 5 (sic !) du code de commerce imposent depuis 2018 aux plus grands groupes français la mise en place de programmes de "vigilance" en matière de droits de l'homme, de libertés fondamentales, de santé, de sécurité, et d'environnement. Cette exclusivité made-in-France a même une vocation universelle puisqu'elle s'impose aux filiales et aux sous-traitants, où qu'ils exercent. La loi Sapin 2 exige pour sa part depuis 2017 – autre originalité française - la mise en œuvre effective de politiques anticorruption. Autre exemple d'une intervention moralisatrice de l'Etat dans la vie des entreprises, le "say on pay" qui alloue depuis 2018 la compétence du Conseil d'administration aux actionnaires en matière de rémunération des mandataires sociaux, dans une logique de paix sociale, dans un pays où, plus que dans d'autres, le citoyen n'aime guère ses entreprises et se défie de ses institutions.
Au-delà de cette évolution de la stricte règle de droit, la responsabilité des entreprises s'engage désormais sur des terrains souvent plus dangereux, comme celui de la réputation. On assiste ainsi au développement du "name & shame" (dans des domaines aussi divers que les pratiques commerciales abusives, les délais de paiement, la fraude fiscale ou la diversité), des campagnes de boycott (p. ex. Danone au Maroc) voire du "procès orchestré", consistant à générer une publicité négative grâce à des actions en justice plus ou moins étayées (p. ex. Lafarge et la Syrie, Total en Ouganda…), l'objectif, prisé par les ONG, étant surtout la mise à l'index d'une entreprise.
Dernier levier, d'essence plus contractuelle, l'émergence d'investisseurs dits "ESG", imposant des critères d'organisation (gouvernance, compliance) et d'actions à finalités environnementale et sociale. Dans ce registre, on notera d'ailleurs l'émergence, depuis 2014, de labels plus ou moins exigeants, de l'entreprise à mission (Loi Pacte) aux modèles issus de l'économie sociale et solidaire (Loi ESS), permettant d'ancrer des objectifs et impératifs sociétaux dans l'ADN capitaliste d'entreprises du secteur concurrentiel.
Alors, quelle est la place de l'avocat d'affaires dans cela ? Mais tout naturellement dans son rôle naturel de conseil et de défense. Car si les instruments évoluent, la règle de droit s'élargit et les enjeux de la soft law s'alourdissent, notre rôle demeure : permettre aux entreprises de réaliser leur objet en conformité avec ces nouvelles exigences. Evolutives dans leur objet, mais surtout aussi dans leur nature même, elles sont le reflet d'attentes d'une Société en quête de "vertu", rétive à l'idée même d'une prééminence de principe de l'impératif économique. Or, que la vertu soit imposée par une règle de droit, la pression de pairs, de clients ou d'investisseurs, ou la vox populi, elle cesse d'être une simple aspiration morale pour devenir partie intégrante, au même titre que toute autre règle de droit, des processus décisionnels.
Ces transformations ne datent pas d'hier. Mais elles vont sans doute s'accélérer dans les mois et les années qui suivront la crise impensable que nous traversons. C'est cette mutation que nous devons accompagner, en adaptant nos compétences, dans une logique non pas moralisatrice ou vertueuse, qui n'est pas de notre ressort, mais d'adaptation à de nouveaux cadres normatifs.
Philippe PORTIER
associé,
responsable du département Corporate Finance, Governance & Compliance,
co-animateur du Groupe Transversal Intégrité & Conformité,
JEANTET AARPI
::: PREVOIR DE NOUVEAUX GARDE-FOUS , par Laure LAVOREL et France SIMON
Faisons fi des idées reçues sur les juristes !! Les anglo-saxons ne sont pas les seuls à concevoir et appréhender au quotidien le droit comme « une arme stratégique », ou à tout le moins comme l’une des composantes d’une décision stratégique. Plus des deux tiers des directeurs juridiques*, membres du Cercle Montesquieu, sont membres d’un COMEX. Cela démontre, si cela est encore nécessaire, que les dirigeants des entreprises françaises sont convaincus de tout l’intérêt de la prise en compte des données juridiques dans un contexte économique et financier. Les impacts de l’extraterritorialité du droit américain, les lourdes sanctions des diverses autorités de contrôle ont sans doute contribué à créer un électrochoc favorable à cette nouvelle appropriation du droit. Peut-il en être autrement lorsque l’on constate, par exemple, l’empilement des textes applicables en cas d’acquisition ou de cession d’une entreprise ?
La prévention ainsi que la gestion des risques sont au cœur de la fonction du directeur juridique. Son rôle est d’alerter la direction générale, les directions fonctionnelles et opérationnelles sur les risques, les gérer dès qu’ils apparaissent et faire preuve de pragmatisme en proposant des solutions concrètes compatibles avec l'activité, la culture et la stratégie de l'entreprise. Dans la recherche de solutions, dans le cadre de dossiers complexes, les directeurs juridiques sont reconnus comme faisant preuve de «leadership». Au moment où le confinement a été déclaré, en raison de la pandémie liée au Covid-19, la mobilisation des directeurs juridiques a été immédiate et totale. La maitrise de la réglementation mise en place, jour après jour, pour faire face à cette pandémie, est essentielle pour aménager les relations commerciales préexistantes à cette crise sanitaire mais aussi à l’organisation du travail du personnel. La portée des clauses contractuelles relatives à la force majeure, à l'imprévision et autres exceptions d’inexécution par anticipation a particulièrement retenu l'attention des directeurs juridiques en raison des enjeux commerciaux y afférents et a fait l'objet de nombreux débats.
Pendant cette période, le Cercle Montesquieu apporte une aide vigoureuse à ses membres en télétravail. Leur exercice quotidien est soutenu par de nombreuses actions de solidarité, par la publication quotidienne de flashs d’information, par l’accès à une véritable base de données accessible sur le site de l’association, grâce à une communication permanente sur les réseaux sociaux et au travers de la mise en place de webinars conçus avec l’EFB, en collaboration avec l’ENM. Une cellule de crise composée de plusieurs membres du Cercle a été constituée en soutien des actions du Conseil d’administration. Notons que la digitalisation des directions juridiques est certainement la clef du maintien de l’activité et qu’elle constitue une aide considérable pour les entreprises.

Demain chaque entreprise devra mesurer ses forces et faiblesses (ainsi que celles de ses concurrents) apparues pendant cette crise exceptionnelle, prendre des mesures correctrices et prévoir de nouveaux garde-fous. Les directeurs juridiques seront à la manœuvre pour notamment modifier en conséquence les contrats, proposer de nouvelles règles de gouvernance par exemple en introduisant plus de flexibilité dans les statuts des sociétés.
La notion de risque qui est au centre du contrôle de la compliance sera peut-être à appréhender d’une nouvelle façon en liaison avec les autorités de contrôle.
En tout état de cause, il appartient aux associations de juristes de poursuivre leur accompagnement et leur contribution au droit positif, pour des directions juridiques plus agiles, toujours plus adaptées aux nouveaux modèles économiques et davantage portées par l’innovation technologique.
Le directeur juridique du XXIème siècle sera bien un « juriste augmenté », mais un homme ou une femme également doté des qualités humaines et émotionnelles propre à un dirigeant, acteur incontournable du mouvement vers une responsabilité sociétale de l’entreprise.
Laure LAVOREL, France SIMON,
Présidente du Cercle Montesquieu Membre du Cercle
*Cartographie des Directions Juridiques 2018
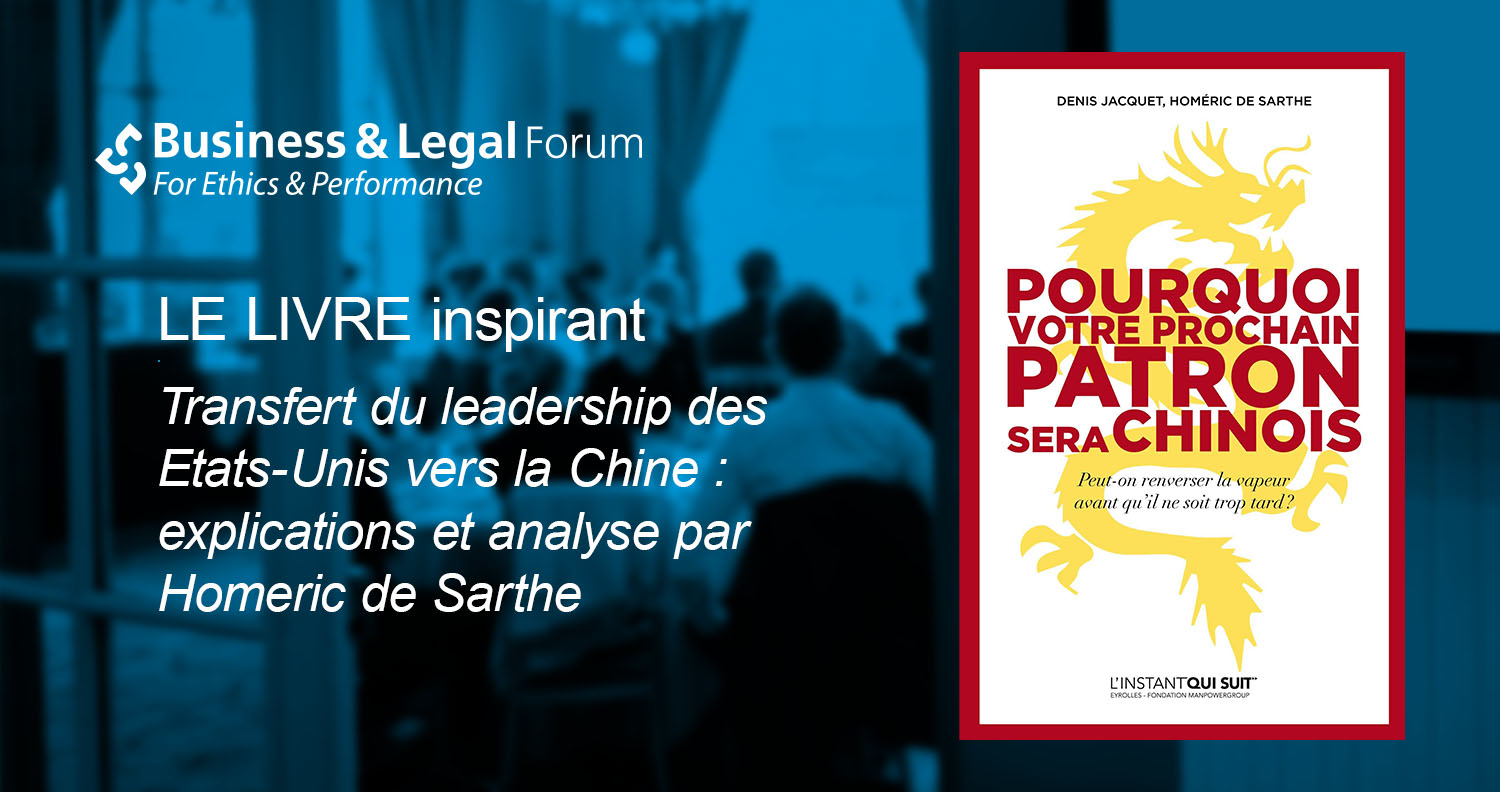
::: UN LIVRE INSPIRANT
L'idée du livre m'est venu dans les semaines qui ont suivi mon retour en France (Octobre 2016), dès lors que j'ai réalisé que malgré le niveau d'information dont nous disposons en France, il m'arrivait très souvent de rencontrer sur Paris des personnes qui imaginaient de la Chine, un pays où règne désordre, saleté et pauvreté. Je me suis dis à ce moment là, que le meilleur moyen de ne pas se répéter était de coucher sur papier mon expérience non seulement en tant qu'étranger en Chine, mais surtout en tant qu'étranger parlant chinois et vivant parmi les chinois.
L'idée du livre m'est venu dans les semaines qui ont suivi mon retour en France (Octobre 2016), dès lors que j'ai réalisé que malgré le niveau d'information dont nous disposons en France, il m'arrivait très souvent de rencontrer sur Paris des personnes qui imaginaient de la Chine, un pays où règne désordre, saleté et pauvreté. Je me suis dis à ce moment là, que le meilleur moyen de ne pas se répéter était de coucher sur papier mon expérience non seulement en tant qu'étranger en Chine, mais surtout en tant qu'étranger parlant chinois et vivant parmi les chinois. L'élément déclencheur fut ma rencontre avec Denis, autour d'un thé, sous la verrière de l'InterContinental à Paris. Nous partagions la même vision du monde, bien que nos expériences soient radicalement différentes. C'est justement ce qui nous a donné envie d'écrire le livre ensemble. J'avais déjà le titre en tête, il ne restait plus qu'à coucher notre vision sur le papier. La situation actuelle est en train d'accélérer le transfert du leadership des Etats-Unis vers la Chine, nous expliquons pourquoi et comment dans le livre. H.DS
Homéric de SARTHE est directeur général de PITCHBOY, startup spécialisée dans la formation professionnelle et les nouvelles technologies (reconnaissance vocale, réalité virtuelle, intelligence artificielle...). Avant de revenir en France fin 2016, il vécu pendant 7 années en Chine (Shanghai et Shenzhen). Diplômé d'un Bachelor de l'université Fudan de Shanghai puis d'un Master de l'ICD, il commence sa carrière d'entrepreneur en ouvrant le bureau de Shenzhen pour Dragonfly Group (cabinet de conseil en ressources humaines franco-chinois). Après cette première expérience, l'entreprenariat ne le quittera plus.
::: PETITS ESSAIS PROSPECTIFS : LE DROIT ET SES PRATICIENS APRES LE COVID-19- partie 1
Lors de la crise économique de 2008, le Business and Legal Forum demandait à Christine Lagarde, alors ministre de l’économie : « le droit est-il le maillon faible de l’économie ? ».
Nous vivons actuellement une crise différente, celle sanitaire liée au COVID 19. Cette crise balaye notre organisation du travail traditionnelle et bouleverse notre quotidien. « Le propre d’une crise c’est de faire émerger un élément de nouveauté inattendu » énonçait Hannah Arendt. Quelles perspectives cette crise met-elle alors en exergue ? Ne nous permet-elle pas de repenser l’articulation du droit et de l’économie, ainsi que le rôle joué par les acteurs de ces deux domaines structurants de notre société ? L’économiste Thomas Piketty nous interroge sur la transformation de notre système économique, en soulignant qu’il « ne suffit pas de dire qu’il faut changer ce système, mais qu’il faut décrire quel autre système économique, avec quelles autres organisations de la propriété et quels autres critères de décision. Il faut remplacer le PIB et sa maximisation par d’autres notions. »
Amis juristes, souvent pompiers pour éteindre l’incendie, et si vous preniez la parole pour un essai prospectif sur l’organisation d’un autre système économique. Le droit n’est-il pas le garant d’un système économique vertueux ?
::: FAIRE DECOLLER L'AVION, par Pierre Berlioz
Cette image de maillon faible correspond malheureusement à la vision la plus répandue du droit et de ses rapports avec l’économie.Gendarme d’une économie qui fonctionne selon sa dynamique et ses propres lois, le droit est conçu essentiellement comme un garde-fou, destiné à poser des limites à l’exercice des activités économiques pour en prévenir et surtout réprimer les abus. Dans cette conception, la règle de droit est presque systématiquement perçue comme une contrainte, parfois même un frein à l’activité lorsque les limites posées paraissent l’avoir été trop strictement. L’excès de loi est alors fréquemment dénoncé, mais aussi bien souvent le vide juridique. Il n’y a là cependant aucun paradoxe : vue comme un cadre contraignant, la règle doit être toujours plus précise, pour rassurer sur ce qui est autorisé. Quant à la réflexion juridique, elle n’est en général considérée que comme secondaire, puisqu’elle force l’intégration d’un élément exogène potentiellement perturbateur de l’activité projetée. En outre, la dimension contentieuse attachée à l’image répressive de la règle, tout comme la rigidité associée à cette même image, conduisent le plus souvent à envisager cette réflexion davantage en aval, en cas de difficulté, qu’en amont, lors de la prise de décision. Dans cette perspective, le droit constitue donc davantage une charge qu’une valeur, et peut dès lors être considéré comme un maillon faible de l’économie.

Le droit est pourtant bien autre chose que cela. Loin d’être une entrave, il est un atout. Il en va en effet de la règle de droit comme des lois de la physique. Ceux qui savent les utiliser sont capables de faire voler un avion, ceux qui ne le savent pas restent au sol. Le droit n’empêche pas, il permet. Il suffit de se rappeler Rousseau : « ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède ». L’objet principal du droit est d’imposer aux tiers le respect des situations qui sont constituées sous son égide et qu’ils pourraient à défaut méconnaître à tout moment. Dit autrement, le droit est aux faits ce que la coquille est à l’œuf.
La réflexion juridique doit par conséquent être intégrée à la prise de décision et non pas intervenir une fois celle-ci prise. Sollicitée à la fin du processus, l’intervention du juriste est vue comme un frein, parce qu’il doit configurer une opération conçue sans tenir compte de lui, avec le risque que réalisée après coup cette configuration soit fragile. Appelé au début du processus, il assure la solidité de l’édifice. C’est pourquoi la conformité juridique doit être assurée dès la conception. En outre, dans un monde où la transparence et la vertu sont des valeurs fondamentales, la rigueur juridique constitue une plus-value importante permettant de gagner des parts de marché. La conformité, vecteur de confiance, devient un élément clé de la valeur de l’entreprise. Dans cette perspective, il est impératif de promouvoir un changement d’image du droit. Celui-ci ne peut plus être vu comme une contrainte technique. Il constitue un réel atout stratégique.
Cette action n’est possible qu’avec le soutien et même l’impulsion des pouvoirs publics. L’Etat doit développer une réelle stratégie d’intelligence juridique, à l’instar de ce qui existe en matière d’intelligence économique. Cela suppose de renforcer l’attractivité du droit français, en particulier par la conduite d’analyses économiques des normes et par le retour à ce qui a fait sa force : la logique, la simplicité et la cohérence d’un droit codifié. Cela implique également de le promouvoir en favorisant la diffusion de l’information et de la culture juridique françaises, notamment grâce aux nouvelles technologies et à l’open data des décisions de justice. Il convient encore de favoriser le développement de formes modernes de droit, comme le droit souple et la justice négociée. Enfin il est nécessaire de soutenir les professions du droit et favoriser les actions interprofessionnelles, car il n’est pas de système juridique performant sans des professions du droit fortes et travaillant de concert.
Pierre BERLIOZ,
professeur de droit,
directeur de l'Ecole de formation des barreaux,
ancien conseiller du Garde des Sceaux,
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
::: PALLIER LES DEFAILLANCES DU MARCHE, par Christophe Lapp et Franck Valentin
Le droit est une science prédictive, comme le sont les mathématiques, en ce que des faits donnés emportent des effets juridiques connus à l’avance, par la qualification qui leur est donnée et les règles qui en résultent.
Le droit ne doit pas ainsi se résumer à un empilement de textes qui constituent aujourd’hui ce qu’il est convenu d‘appeler la réglementation, incluant des sources aussi disparates que la loi, le règlement, les normes, et sans omettre les directives européennes éventuellement directement invocables, ni même le droit mou, ou soft law, qui s’élabore hors du contrôle du législateur, dont la compréhension est réservée à quelques initiés.
Le droit ne doit pas être seulement passif, à vouloir se contenter de régir des difficultés passées dans l’attente de nouvelles pour y répondre à nouveau trop tard, subissant ainsi les événements au lieu de les précéder. Il y perdrait ce qui en fait son essence et son acceptation par chacun : sa capacité à régir l’avenir, mais un avenir commun et partagé.
Le droit se doit d’être un art pratique, in media res, capable d’appréhender les faits dans leur complexité croissante en sorte de parvenir à l’accomplissent de buts que les communautés humaines se sont fixées.

Notre vulnérabilité que la crise du coronavirus nous rappelle douloureusement, et que nous avions oublié par notre confort matériel, du moins pour les sociétés les plus prétendument avancées ayant pourtant placé le droit au centre du dispositif démocratique, et par notre arrogance à croire à notre domination sur la vie, doit nous conduire, plus qu’avant, à agir ensemble sur la redéfinition de nos buts essentiels qui devront être assignés au droit :
- prévenir les risques systémiques que les sociétés de marchés, comme les économies dirigées, se sont révélées incapable de faire, dont ceux de la fragmentation du monde et ceux des pandémies qui jalonnent l’histoire de nos sociétés et de leurs métaphores modernes que sont les propagations « virales » de logiciels malveillants destructeurs de systèmes d'information et de richesses associées, de fausses nouvelles néfastes avec leurs effets dévastateurs sur les personnes, ou d’effondrements économiques, en réencastrant l’économie dans les rapports sociaux ;
- prévenir l’irresponsabilité en affirmant notre liberté sans laquelle il n’y a pas de responsabilité.

La confusion trop souvent entretenue est de croire que ces visées soient antagonistes pour réglementer plus encore et corrélativement déresponsabiliser davantage. Tout au contraire, elles s’allient dans un objectif commun qui est de dépasser l’immédiateté de la rationalité individuelle pour tendre vers un futur réellement plus démocratique.
Christophe LAPP et Franck VALENTIN,
avocats associés,
ALTANA
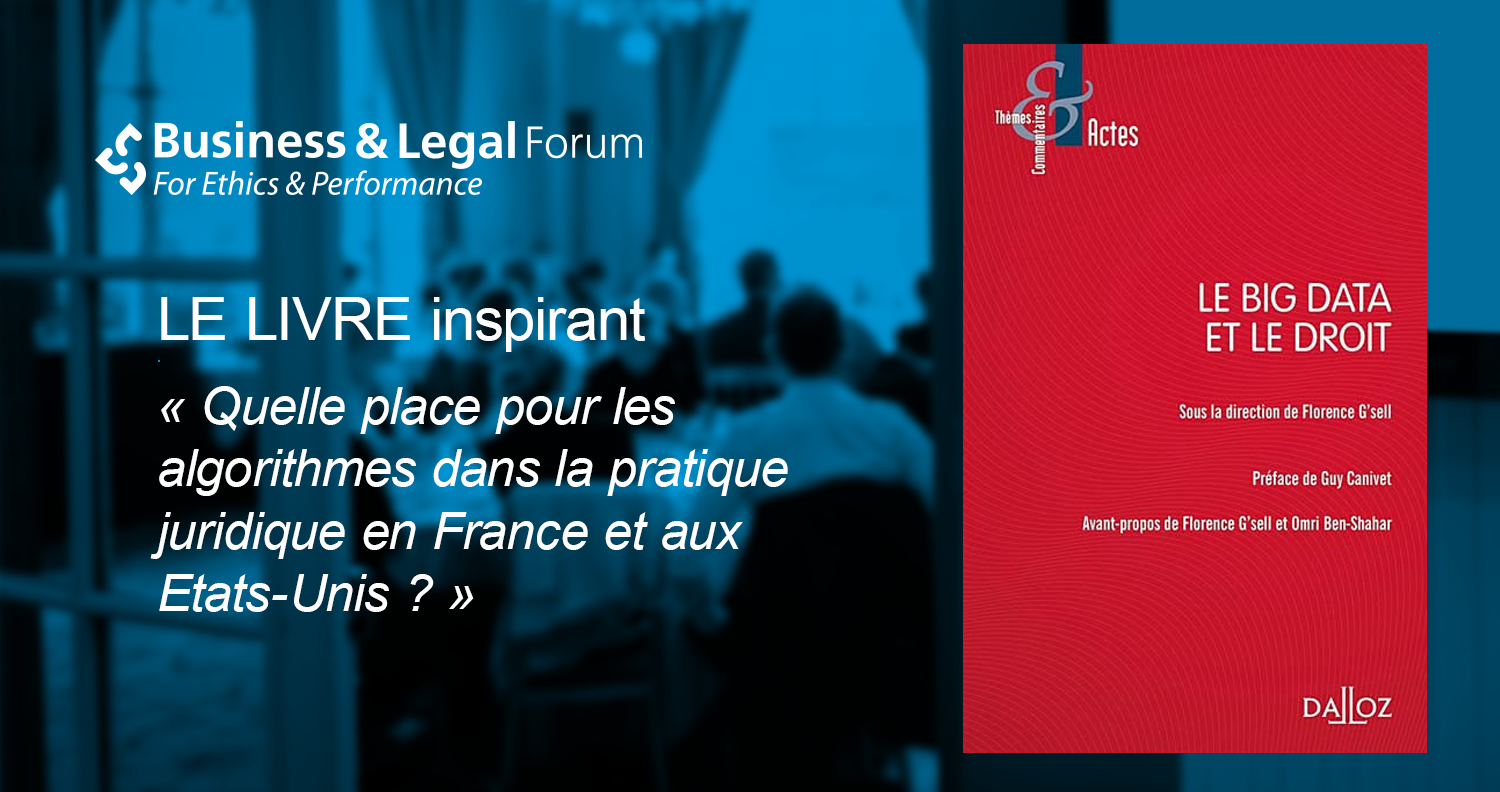
::: UN LIVRE INSPIRANT
La possibilité de collecter et traiter d’immenses gisements de données numériques permet aujourd’hui de disposer d’outils d’analyse sophistiqués en mesure de délivrer, de manière inédite, des informations fines sur les comportements humains et la probabilité de leur apparition. « Le Big Data et le Droit » comporte des contributions qui ont, toutes a pour objet d’envisager l’impact de ces mutations sans précédent sur le droit et la pratique juridique en France et aux Etats-Unis. Le « Big Data » vient-il transformer la production normative, l'activité de juger, le conseil juridique ? Quelle place pour les algorithmes dans le quotidien des juristes ? F.G
Florence G’SELL est professeure de droit privé à l’Université de Lorraine, chercheuse associée à l’IHEJ et co-titulaire de la Chaire Digital, Gouvernance et Souveraineté de Sciences Po. Ses travaux portent principalement sur les relations entre le numérique et le droit, notamment dans une perspective de comparaison avec le droit des Etats-Unis.
::: GEOPOLITIQUE ET DROIT PENAL
Les entreprises françaises sont-elles mieux armées ?
La dépénalisation de la vie des affaires n’est plus à l’ordre du jour. Les législations sont plus strictes, les sanctions plus lourdes, les prescriptions plus longues et la coopération judiciaire internationale s’organise… Comment les entreprises et les dirigeants s’adaptent-ils à ce nouveau contexte ? La culture pénale évolue fortement : comment désormais négocier (ou se défendre) avec les autorités françaises et étrangères ?
::: LA PENALISATION DES AFFAIRES, SAVOIR NEGOCIER LA MEILLEURE DEFENSE
« Le nouveau contexte dans lequel s’inscrit la CJIP traduit un alignement des attentes et des sanctions entre les autorités, rendu possible par une meilleure coopération entre elles. Dorénavant, les outils mis à disposition des autorités, qui discutent entre elles, sont similaires. »
Eric RUSSO,
premier vice procureur financier,
PARQUET NATIONAL FINANCIER.

«Le fait que l’entreprise française ne soit plus seule aux prises avec l’autorité étrangère est un facteur favorable pour elle. Le procureur français devient lui aussi l’interlocuteur de l’autorité étrangère. Il s’opère alors un déplacement du lieu de la négociation, ce qui modifie le rapport de force et garantit une meilleure protection de l’entreprise et des intérêts français. »
Eric RUSSO
« Les entreprises, quand elles sont visées par ces enquêtes, ont désormais la possibilité d’obtenir de plusieurs autorités qui discutent et coopèrent une résolution globale et simultanée, avec des délais équivalents. »
Eric RUSSO
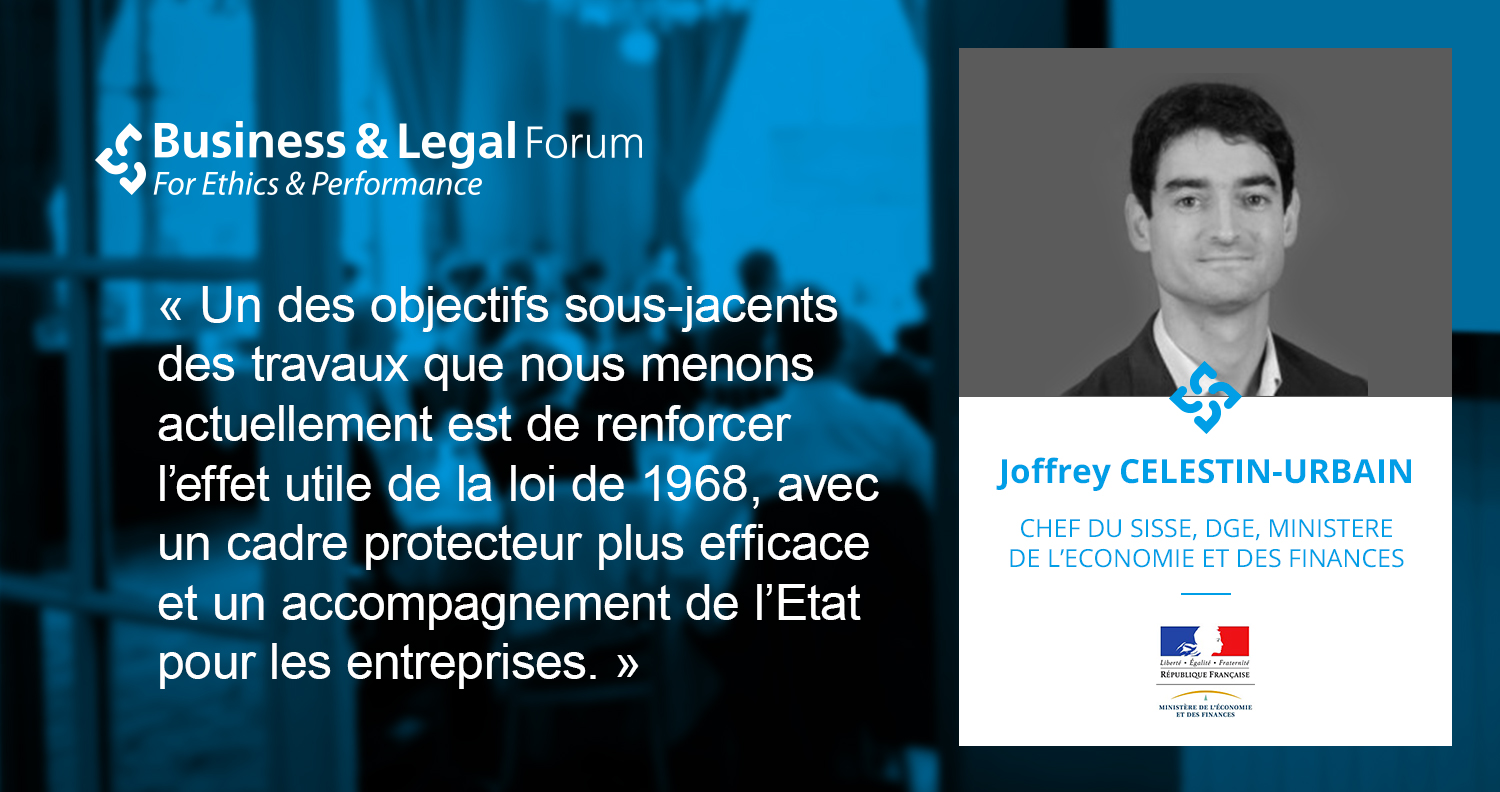
« Un des objectifs sous-jacents des travaux que nous menons actuellement est de renforcer l’effet utile de la loi de 1968, avec un cadre protecteur plus efficace et un accompagnement de l’Etat pour les entreprises confrontées aux demandes d’informations des autorités étrangères. »
Joffrey CELESTIN-URBAIN,
Chef du service de l’information stratégique et de la sécurité économiques,
Direction générale des entreprises,
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
::: QUELS OBSTACLES RESTENT-ILS A LEVER ?

« Une partie du chemin a été effectué, mais de nombreux sujets restent à traiter, comme le périmètre de la transaction conclue, la possibilité de conclure une ou plusieurs CJIP, la confidentialité des informations dans le cadre de CJIP ou encore le sort de celles-ci en cas d’échec de la CJIP. Par ailleurs, la loi dite de blocage est en réalité une loi de communication dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire : elle mérite donc d’être renforcée et respectée, ce qui favorisera l’entraide et donc un certain niveau de garanties pour le justiciable. »
Kiril BOUGARTCHEV,
avocat associé,
BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES.

« Même si un programme de compliance efficace est mis en place au sein d’une entreprise, des cas d’infraction isolée persisteront. L’autorité judiciaire ou administrative devrait donc tenir compte de l’investissement massif d’une entreprise dans le programme de compliance efficace afin d’alléger la sanction. »
Christoph GEIGER,
directeur juridique,
SIEMENS FRANCE.
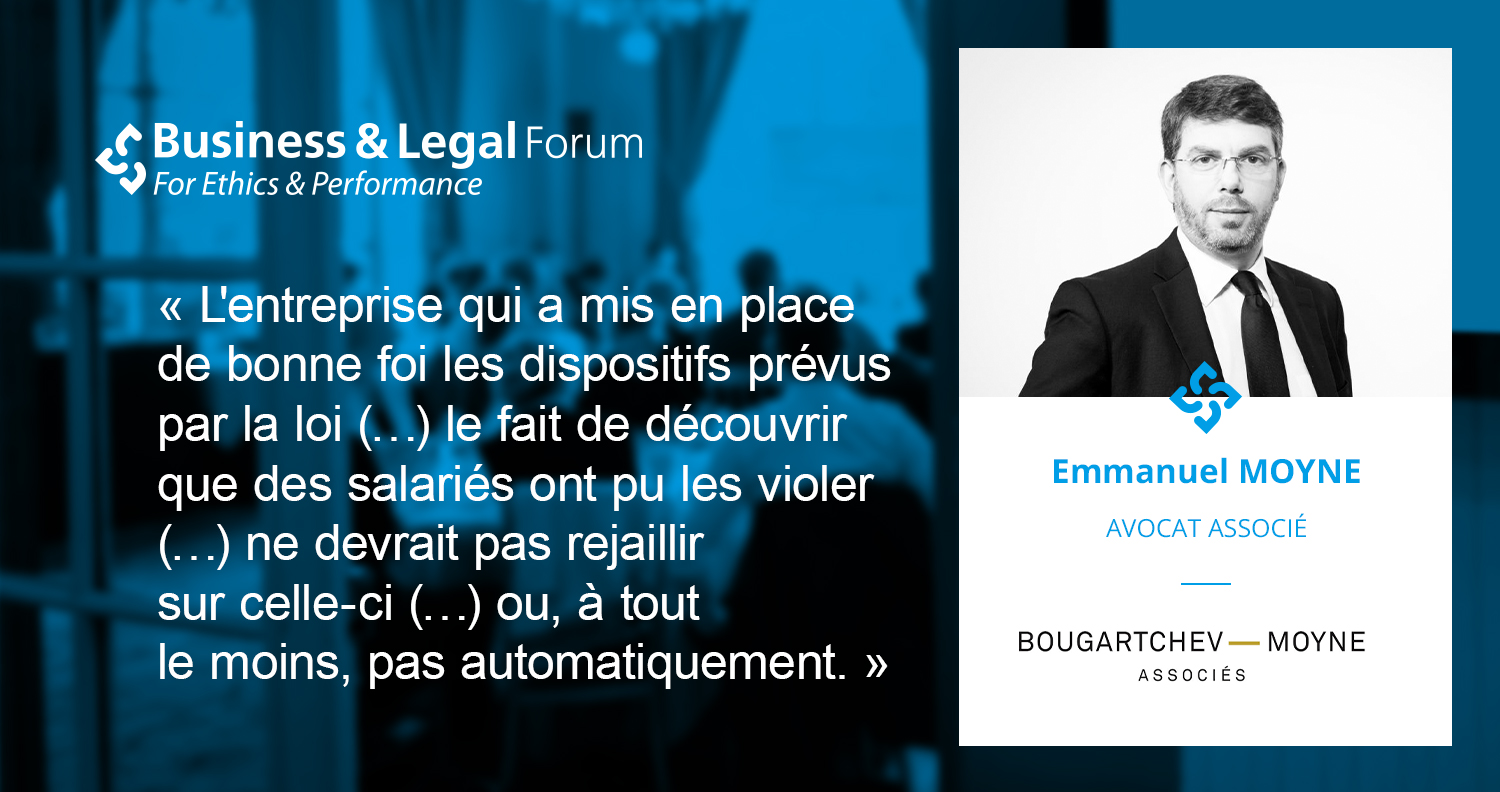
« A partir du moment où l’entreprise a mis en place de bonne foi les dispositifs prévus par la loi concernant la prévention des infractions, le fait de découvrir que certains salariés ont pu violer les dispositifs ainsi mis en place par l’entreprise ne devrait pas rejaillir sur celle-ci, qui ne devrait donc pas voir sa responsabilité pénale engagée ou, à tout le moins, pas automatiquement ».
Emmanuel MOYNE,
avocat associé,
BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES.
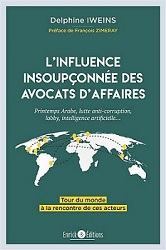
::: UN LIVRE INSPIRANT
Qu'ils soient Prix Nobel de la Paix, premier bâtonnier noir aux Etats-Unis, conseiller au commerce extérieur, anonyme exerçant en cabinet ou en entreprise, les avocats d'affaires participent activement à la vie économique politique et sociale de leur pays. Cette enquête de terrain propose de partir à leur rencontre aux quatre coins du monde : en Tunisie, en Russie, à Hong Kong, aux Etats-Unis, au Brésil et en France.
Journaliste juridique depuis dix ans dans la presse professionnelle et généraliste, Delphine IWEINS exerce aujourd'hui dans un quotidien économique national. Elle est aussi membre fondateur du Cercle des Journalistes Juridiques.
::: COMPLIANCE : L’ORGANISER, LA RENDRE CREDIBLE ET DONNER DU SENS
Directeur compliance, comment organiser sa fonction conformité selon l’organisation et les ressources de son entreprise ? Comment la fonction compliance doit-elle interagir avec les autres directions et les opérationnels ? Comment mobiliser l’instance dirigeante, les fonctions de l’entreprise et interagir avec l’AFA ? Comment faire de la compliance un atout ?
::: L’ORGANISER

« La loi permet à l’AFA de donner aux acteurs économiques des clés et c’est là tout l’intérêt et la limite de l’activité de conseil de l’agence. La souplesse par rapport à la taille de l’entreprise, leurs moyens, etc, justifie qu’il n’y ait pas d’effet contraignant officiel. »
Xavier BECCALORI,
chef du département d’appui aux acteurs économiques,
AFA.

« L’AFA fait des préconisations mais l’entreprise reste libre dans sa gestion. L'enjeu pour l'entreprise est d’être capable de prouver que ses choix permettent la mise en œuvre d'une conformité opérationnelle. Ainsi la fonction conformité est-elle plus efficiente si elle est autonome, intégrée au contrôle interne ou à la fonction juridique ? »
Nathalie KALESKI,
auteur de l'étude : Les entreprises face au défi de l’anticorruption, INSTITUT FRIEDLAND,
coordinatrice scientifique, BUSINESS & LEGAL FORUM.
« La tendance consiste à réussir à allier direction conformité, risque et contrôle interne. Mais le risque est de paralyser un niveau de contrôle. »
Jean-Baptiste CARPENTIER,
directeur de la Conformité,
VEOLIA.
::: LA RENDRE CREDIBLE

« L’essentiel est de prendre en compte les enjeux organisationnels et budgétaires de l’entreprise. Surtout, la conformité étant par nature transversale, un défi pour le responsable conformité est de dépasser l’organisation en « silo » des entreprises et d’avoir la capacité de mobiliser ses ressources afin qu’elles réalisent les tâches qui leur incombent en application du programme de conformité. »
Franck VERDUN,
avocat associé,
VERDUN VERNIOLE.
« Le budget est très difficile à déterminer car une partie non négligeable de la conformité n’est pas directement portée par elle et pourtant le budget peut être important (ex : conformité achat).En ce qui concerne l’AFA le constat est simple. D’un côté, le conseil de l’AFA peine à mobiliser l’instance dirigeante par rapport aux autres fonctions de l’entreprise. Mais lors d’un contrôle sur place et pièces, le principal interlocuteur est souvent le dirigeant. »
Jean-Baptiste CARPENTIER
::: LUI DONNER DU SENS
« La compliance permet aux entreprises de se prémunir des risques de corruption et de réputation qu’ils impliquent. Surtout, la conformité bien pensée crée de la valeur. En terme organisationnel, elle structure l’entreprise en créant des procédures. Les outils qui sont mis en œuvre, notamment digitaux, permettent au dirigeant de disposer d’une visibilité sur l’organisation de l’entreprise, ses usages et pratiques. La conformité et ses outils permettent également de recueillir de la data (exemple de l’évaluation des tiers) et de l’exploiter dans le respect des termes du RGPD. »
Franck VERDUN

« Le ROI de la compliance, à supposer qu’il soit chiffrable, il est aujourd’hui difficile à définir. Mais au-delà de ces aspects chiffres, il y a une vision de rationalisation des activités de l’entreprise et une tendance vers de nouveaux modes de réflexion très porteurs. »
Jean-Baptiste Carpentier
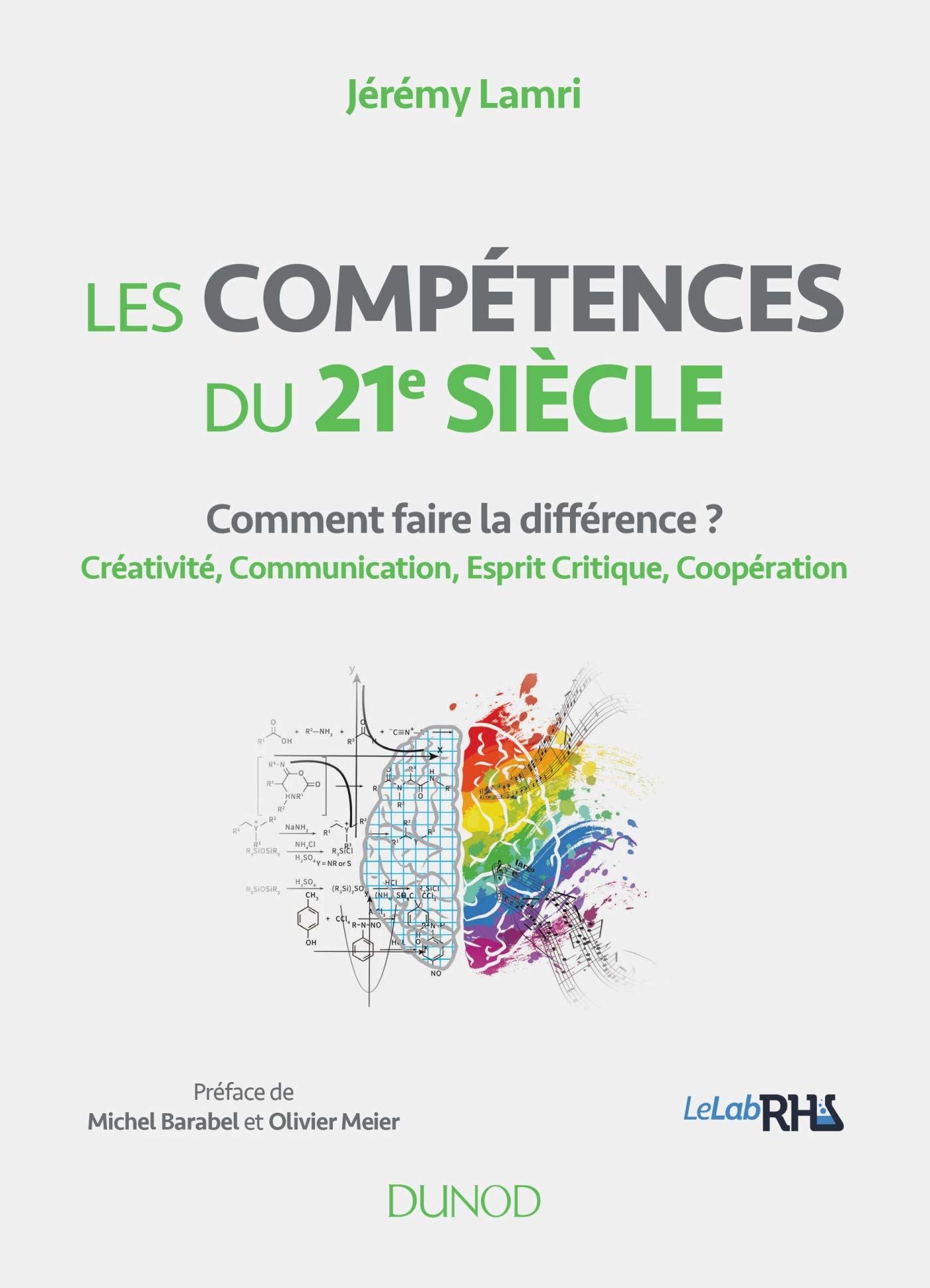
::: COMMENT S'EPANOUIR DANS LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN ?
Pour se hisser au sommet de la chaîne alimentaire et surpasser ses prédateurs naturels, l’homme a dû faire preuve d’une grande ingéniosité. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de faire face à la nature, mais de se faire une place dans une société où l’intelligence artificielle défie l’humanité. Confronté à cette réalité, l’homme n’a d’autres choix que de poursuivre son évolution grâce à la meilleure de ses armes : le cerveau. Pour survivre aux menaces de l’environnement, il doit parfaire sa faculté d’adaptation et développer une intelligence nouvelle. Face à cette urgence, comment notre cerveau va-t-il réagir ? Comment remettre au cœur du monde créativité, esprit critique, communication et coopération ? Sur un ton engagé et enthousiate, l’auteur met en lumière les quatre grandes compétences qui permettront à l’homme de s’épanouit pleinement dans le monde de demain. Car rien n’est joué, tout est à faire.
Jérémy LAMRI est un entrepreneur, cofondateur de Monkey tie, du Lab RH et du Hub France IA. Il dirige actuellement le Pôle Recherche & Innovation de JobTeaser, leader européen de l’emploi et de l’orientation des jeunes. Il a étudié à Oxford et HEC Paris, et détient un doctorat en psychologie de Paris Descartes. Il est l’auteur de deux ouvrages publiés aux éditions Dunod : Innovations RH et Les Compétences du 21ème Siècle. Conférencier sur les sujets de futur du travail, des RH, des organisations et écosystèmes, il enseigne également, à HEC Paris, Sciences Po Paris et Mines Telecom.
::: LES ENTREPRISES FACE AUX ENQUETES
ADLC, AFA, AMF, pénales… Quels réflexes adopter ?
L’AFA a mis en place ou projette d’établir des protocoles de coopération avec l’ADLC, l’AMF, l’APCR et plusieurs parquets afin « de tisser des toiles de coopération [et de] faire notre travail au mieux » précise Salvator Erba, sous-directeur du contrôle de l’Agence Française Anticorruption. Dès lors, comment les entreprises doivent-elles s’organiser en interne et travailler avec les différentes autorités ? Comment les différentes autorités peuvent-elles coopérer et quelles conséquences cela implique-t-il ?
::: ANTICIPER SA COOPERATION

« Pour répondre aux questions éthiques et de compliance, la préparation de l’entreprise est essentielle. En ce sens, la première chose est de ne pas tricher, il faut collaborer et cela ne signifie pas se soumettre. L’objectif pour l’entreprise est d’être prête en disposant de l’ensemble des documents (cf. Guide de l’Autorité de la concurrence) et de savoir comment permettre l’accès à ses documents tout en respectant les droits de la défense (cf. article 145 du code de procédure civile). L’entreprise peut organiser la gestion de sa conformité par thème (concurrence, éthique, anti-corruption, etc) ou de façon générale. »
Laurent PITET,
directeur juridique et compliance officer,
BAYER HEALTHCARE.

« L’entreprise ne peut plus être préparée à un seul type d’enquête, mais à l’éventualité d’enquêtes multiples (ADLC, AFA, AMF, pénales) ; cela implique de donner aux salariés les bons outils, leur permettant d’avoir les réflexes appropriés dans chaque cas. »
Marta GINER ASINS,
avocate associée,
NORTON ROSE FULBRIGHT.
::: FRANCAIS ET EUROPEENS S’HARMONISENT

« En cas de contrôle, la question qui se pose est comment améliorons-nous la situation en dialoguant avec les autorités ? L’objectif étant d’aller vite à la fois pour l’entreprise et pour l’AFA, nous avons de notre côté mis en ligne un questionnaire qui aide les entreprises à se préparer. On peut envisager que la coordination entre autorités amène notamment à harmoniser les différents questionnaires lorsqu’ils existent. Autre exemple de coordination : récemment, les lignes directrices AFA/PNF ont été publiées et nous observons que ces deux acteurs partagent la même vision : dans le cas de transactions pénales coordonnées entre autorités de poursuite de plusieurs pays, le PNF ferra ses meilleurs efforts pour que l’entreprise n’ait que l’AFA comme moniteur. »
Salvator ERBA,
sous-directeur du contrôle,
AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION.

« Finalement, la collaboration entre les autorités permet à l’entreprise d’anticiper sur l’avenir. »
Laurent PITET,
::: VERS UNE COOPERATION MONDIALE

« Par exemple, dans le programme de mise en conformité de la Société Générale, dans le cadre de la transaction pénale coordonnée entre le PNF et le DoJ, l’AFA réalise seule la mission de moniteur. Ces travaux vont finalement nourrir les comptes rendus de la société au DoJ. »
Salvator ERBA,

« La gestion des enquêtes internationales est délicate. Dans un groupe international, le département conformité est confronté à la diversité des environnements juridiques : un bon programme de conformité exige de mettre en place des procédures globales, tout en prenant en compte les spécificités locales et la dimension culturelle. »
Marta GINER ASINS.
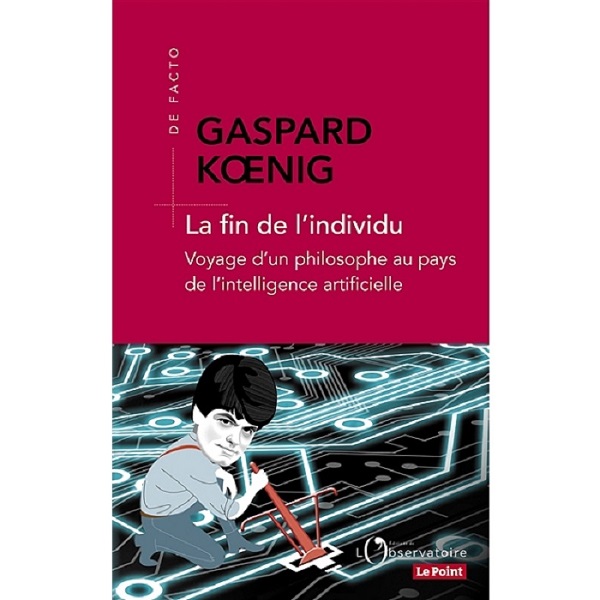
::: OEUVRE INSPIRANTE
Notre système juridique est fondé sur l’idée de responsabilité individuelle. Or si les techniques d’Intelligence Artificielle anticipent et orientent nos comportements au point de nous priver de notre libre arbitre, n’est-ce pas le sujet de droit qui disparaît ?
Cette question est loin d’être abstraite : de Stanford à Bruxelles, des juristes réfléchissent à créer une personnalité juridique du robot (ou de l’algorithme), comme il y en a pour les entreprises… C’est un pas à surtout ne pas franchir : il faut au contraire rétablir l’agent moral (humain) dans l’univers de l’IA. Ce qui doit passer, à mon sens, par l’instauration d’un droit de propriété sur les données personnelles.
Gaspard KOENIG est philosophe et écrivain. Il s’inscrit dans la tradition du libéralisme français. Depuis plusieurs années, il entreprend des voyages à travers le monde afin de mettre à l’épreuve du réel des idées de philosophie politique. Son dernier ouvrage, La fin de l’individu. Voyage d’un philosophe au pays de l’intelligence artificielle, retrace son périple au contact des grands acteurs de l’IA, des Etats-Unis à la Chine en passant par Israël, le Danemark ou le Royaume-Uni…
::: ANTI-CORRUPTION : LE MONITORING A LA FRANCAISE
Charles Duchaine, directeur de l’Agence Française Anti-corruption (AFA) déclarait « nous pensons avoir autorité à faire ce monitoring dans les entreprises françaises, qu’il soit imposé par des autorités françaises ou étrangères », et ce, « y compris dans les filiales étrangères ».
Les autorités françaises prennent désormais la main. Lors du Business & Legal Forum, Nicolas BROOKE, Pierre LAPORTE, Julien LAUMAIN, Mokrane MOKHTARI et Philippe GOOSSENS nous ont partagé leur expérience.

« Quelle va être la philosophie des autorités françaises sachant que l’un des objectifs de la loi sapin est de ne pas laisser la main à des autorités étrangères ? Comment anticiper les attentes de l’AFA ? »
Philippe GOOSSENS,
associé,
ALTANA.
::: SE DIFFERENCIER DU DOJ ET DE LA BANQUE MONDIALE

« En amont de la proposition de la CJIP, le parquet peut consulter l’agence afin d’une part, d’apprécier l’opportunité d’imposer ou non l’insertion d’un programme de mise en conformité et d’autre part, de déterminer le plafond des frais d’expertise nécessaire à son éventuelle mise en œuvre. Suite à l’accord de l’établissement d’une CJIP, si celle-ci comporte un programme de mise en conformité, qui ne peut être supérieur à trois ans, celui-ci sera effectué par l’AFA, éventuellement accompagné de ses prestataires sur toute ou partie de la mission. Le système est donc différent de celui déployé lors d’un monitoring de la banque mondiale ou du DOJ. Dernière précision, dans le cadre de ce contrôle, l’AFA pourra se voir fournir l’ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission sur le périmètre défini par la CJIP en France comme à l’étranger. »
Julien LAUMAIN,
responsable section de contrôle,
AFA.

« Dans le cadre d’un monitoring Banque Mondiale, la référence de celle-ci, en matière de compliance se trouve dans les « World Bank Group Integrity compliance guidelines » qui regroupent et font la synthèse de ce qui existe dans le monde en matière de lois anti-fraude et anti-corruption. Lorsqu’une Organisation (entreprise) est prise à défaut, le WBG nomme un Compliance officer qui va définir et instruire le cas plus en détail, et déterminer la sanction (interdiction temporaire ou définitive, mise en place d’un programme de compliance, ou sanction). C’est dans le cadre de la levée de la sanction que, le WBG propose un monitoring à l’organisation prise en faute pour améliorer son programme de compliance et se conformer aux « WBG Integrity Guidelines » et ainsi combattre la corruption. Les sanctions prévues par la banque mondiale peuvent s’appliquer à la fois aux individus et aux personnes morales. Le monitoring peut durer plusieurs années, rythmées par des rapports chaque année sur les progrès du programme de compliance de l’organisation. L’objectif de conformité aux WBG Integrity Guidelines est atteint lorsque le WBG juge que les progrès de l’organisation sont suffisants pour lever la sanction, un rapport final du monitoring est alors établi. En réalité, il s’agit de mettre en place une amélioration du système de compliance sous la contrainte. »
Mokrane MOKHTARI,
associé, expérience d'un monitoring Banque Mondiale,
GOVERNANCES.
::: UN COACHING ANTI-CORRUPTION A LA FRANCAISE
« L’objectif est d’accompagner l’entreprise sous CJIP à définir, mettre à jour, renforcer et déployer son programme de conformité anticorruption tout en donnant l’assurance au parquet que celui-ci est pertinent et efficace sur la totalité du périmètre. »
Julien LAUMAIN,

« Le monitoring est positif pour les entreprises françaises, dans un contexte juridique et social où l'accent est mis sur plus de responsabilité, de prévention des risques et d'auto-régulation. L'AFA devra toutefois démontrer qu'elle sera au niveau de la tâche ambitieuse qui lui incombe, à savoir l'accompagnement des entreprises pour leur permettre d'atteindre les standards internationaux applicables en matière de programmes de compliance anti-corruption. Toutefois, le monitoring post-CJIP doit rester une exception et pas la règle. Les parquets devront définir en fonction de critères objectifs si un contrôle de l'AFA s'impose, en tenant compte des travaux de remédiation d'ores et déjà accomplis, du profil de risque propre à l'entreprise, et de sa réalité opérationnelle. »
Nicolas BROOKE,
associé, ancien directeur juridique contentieux,
Société Générale,
SIGNATURE LITIGATION.

« L’importance d’un moniteur pour des équipes internes de compliance ou de juristes est incontestable car il représente un levier pour aider et accélérer la mise en place de la compliance. Dans les entreprises françaises, qui ont pu être très rétives à sa mise en place, le moniteur a été utile. Même si cela a pu remettre en cause des questions de souveraineté, c’est utile. Ainsi, le directeur juridique ne doit pas avoir peur du moniteur. C’est une institution très efficace de modification des comportements. »
Pierre LAPORTE,
président associé,
GOVERNANCES.
« Les leçons à tirer du monitoring impliquent que quelqu’un d’extérieur à l’entreprise, une autorité reconnue en la matière, conseille l’entreprise pour faire ce qu’il faut dans son organisation et combattre la corruption. »
Mokrane MOKHTARI.
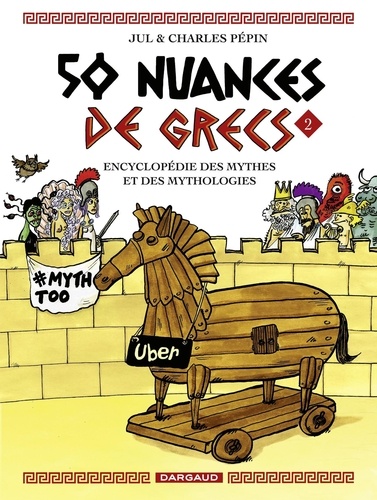
::: SE DIVERTIR
A la toute fin 2019, Charles Pépin a publié avec Jul 50 nuances de Grecs, tomes 1 et 2, une ronde joyeuse et savante en compagnie des dieux de l'Olympe et des héros grecs au grand complet. Une façon de projeter la mythologie dans notre quotidien moderne.
Et il se trouve qu'on y retrouve dans certaines pages le monde du droit ! L'avocate de Zeus listant les conquêtes amoureuses et les enfants illégitimes de son client lui prédira une très grosse pension alimentaire, celui de M.Ulysse qui lui annonce que "ça va être compliqué" si sa femme a tissé une tapisserie pendant 40 ans et qu'il ne peut produire aucune preuve matérielle de son activité...
Une rencontre hilarante entre les mythes fondateurs et notre société contemporaine, chaque planche de Jul étant complétée par un texte de Charles Pépin...
Charles PEPIN, philosophe, essayiste et romancier, il enseigne la philosophie à Sciences-Po et à HEC et mène tambour battant un cycle de conférences hebdomadaires aux cinémas MK2 Odeon et MK2 Bastille à Paris. Il collabore chaque mois à Philosophie magazine et à Psychologies magazine.
::: RECONCILIER LA POLITIQUE DE CONCURRENCE EUROPEENNE AVEC SES AMBITIONS ECONOMIQUES ET GEOPOLITIQUES ?
A l’instar de l’affaire Alstom/Siemens, quelles sont les perspectives des entreprises européennes face aux géants américains et chinois ? Le droit de la concurrence tel qu’il est pensé en Europe est-il toujours adapté au contexte mondial ? Les réactions des différents gouvernements dans le premier Manifesto franco-allemand-polonais semblent montrer un avis tranché sur la question. Est-il envisageable d’introduire dans ce Manifesto, à l’image du pouvoir d’évocation du ministre de l’économie français, une « phase III » dans le contrôle des concentrations au niveau européen ? D’autres alternatives sont-elles envisageables pour améliorer le droit de la concurrence en Europe et le sort de nos entreprises ?
Lors du Business & Legal Forum, quelques pistes de réponse ont été mises en évidence.
::: LA POLITIQUE DE CONCURRENCE DOIT VENIR AU SOUTIEN DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

« Nous demandons à la politique de la concurrence de régler la politique industrielle mais ce n’est pas son rôle. Ce dont l’Europe souffre n’est pas d’un excès de politique anti-trust, mais d’une absence de politique industrielle. La politique de concurrence, loin d’être un obstacle à la politique industrielle, vient plutôt au soutient de celle-ci. »
Emmanuel COMBE,
vice-président,
AUTORITE DE LA CONCURRENCE.

« En parallèle de la politique de concurrence, il faut plus de politique industrielle, en particulier sectorielle, ainsi qu’une défense commerciale plus assumée. »
Pascal BELMIN,
Head of EU regulatory affairs,
AIRBUS GROUP.
::: 2 PRIORITES : TENIR COMPTE DES ACTEURS INTERNATIONAUX, FAVORISER LA R&D

« Afin de réconcilier politique industrielle et de concurrence, il serait utile de faire évoluer le contrôle des concentrations européen par une meilleure prise en compte des efficiences liées au projet concerné, de la concurrence potentielle ou déloyale des entreprises non-européennes, et par la recherche de remèdes plus proportionnés que des remèdes de cessions d'actifs, avec l'aide de spécialistes des secteurs concernés. »
Laurent GODFROID,
avocat associé,
GIDE LOYRETTE NOUEL.
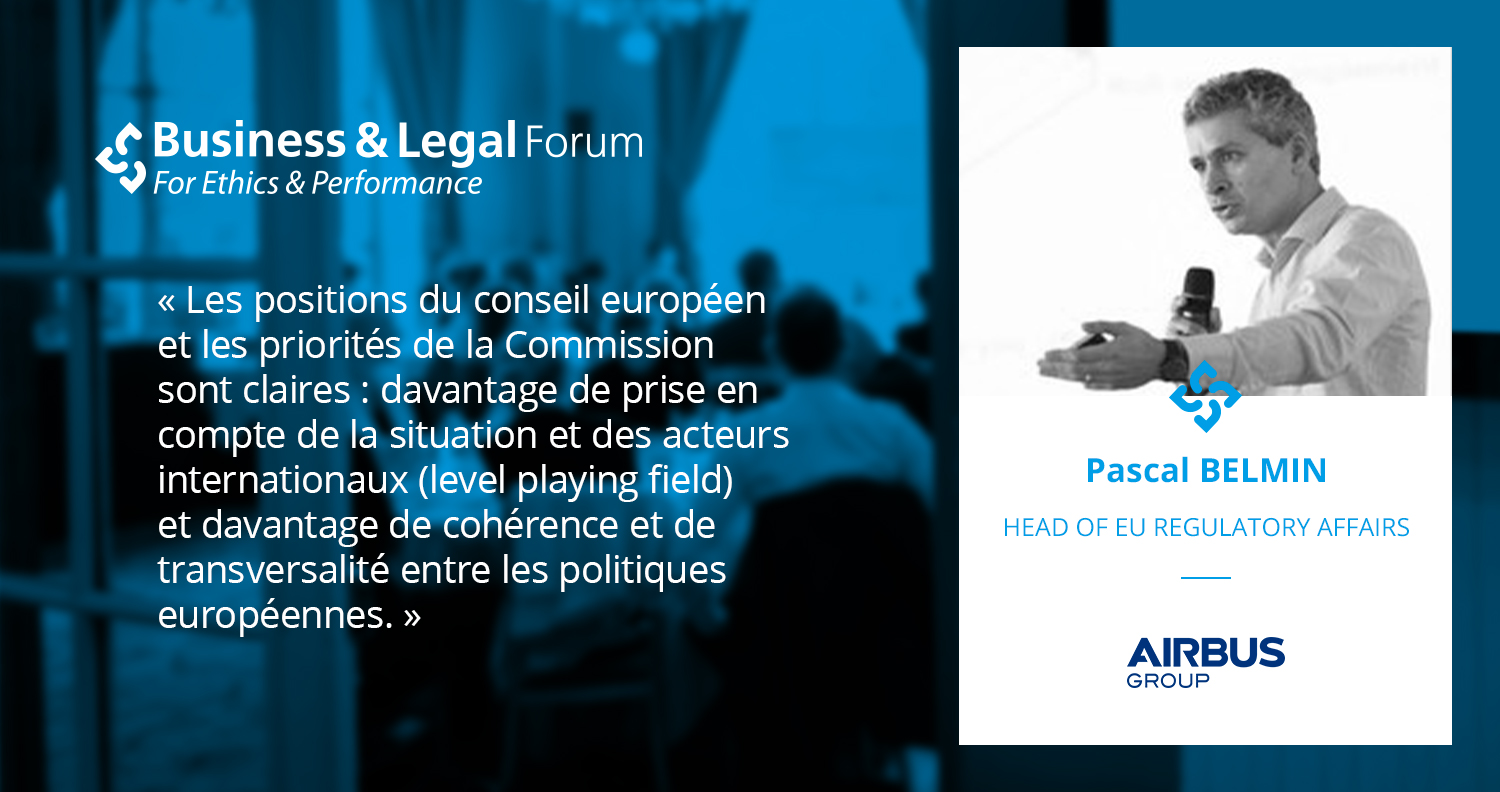
« Les positions du Conseil européen et les priorités de la Commission sont claires : davantage de prise en compte de la situation et des acteurs internationaux (level playing field) et davantage de cohérence et de transversalité entre les politiques européennes. La structure de la nouvelle Commission va en ce sens. »
Pascal BELMIN,
Head of EU regulatory affairs,
AIRBUS GROUP.

« Le principal problème de l’UE et de la France, c’est la faiblesse des investissements en R&D. Ainsi, l’adaptation de la politique de la concurrence n’est pas un remède suffisant au manque de politique industrielle, il faut financer la R&D. »
Emmanuel COMBE,
vice-président,
AUTORITE DE LA CONCURRENCE.
::: L'ENTREPRISE FACE A L'AUGMENTATION DU RISQUE PENAL :
DRH, DIRECTEURS JURIDIQUES, COMMENT LE PREVENIR ET LE GERER ?
Le risque pénal des entreprises s’est accentué et les risques pénaux en droit du travail n’y échappent pas, bien au contraire ! L’évolution réglementaire, l’allongement des délais de prescription et le renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail ont largement contribué à augmenter ce risque.
Comment l’entreprise vit cette culture pénale dans le monde des affaires ? Qui supporte le risque pénal dans l’entreprise ? Comment s’en prémunir : quels sont les outils et bonnes pratiques ?
Lors du Business & Legal Forum, les intervenants de haut vol ont donné leurs points de vue sur ces différents enjeux majeurs.
::: RISQUE PENAL POUR L’EMPLOYEUR ET LE DRH

« Malgré la confirmation d’un tempérament apporté par la mise en place des amendes administratives, il y a une inflation du droit pénal et les employeurs sont soumis à des risques importants. Les contrôles de l’inspection du travail (par exemple, les « raids » dans les entreprises avec des contrôles simultanés de plusieurs sites) et la sévérité du juge sont montés en intensité. »
David JONIN,
avocat associé,
GIDE LOYRETTE NOUEL.

« L’employeur se trouve dans une position de plus en plus compliquée : les obligations se multiplient et s’accentuent, la charge de la preuve repose la plupart du temps sur lui, ainsi il existe une grande insécurité juridique pour les employeurs et les DRH. »
Stéphanie LECERF,
HR & Legal director,
présidente de l'Association "A Compétence Egale"
PAGEGROUP.
::: PRESSION SUR L’ENTREPRISE

« La peur du pénal est devenue une menace et un moyen de pression sur l’entreprise. »
Marie-Lucie DUBOIS,
responsable contentieux social,
AIR France.

« Le risque de réputation est plus fort que le risque pénal. La situation est encore plus complexe dans les groupes internationaux du fait de règles différentes selon pays. »
Stéphanie LECERF,
HR & Legal director,
présidente de l'Association "A Compétence Egale"
PAGEGROUP.
::: LES BONNES PRATIQUES

« L’arme pénale est de plus en plus utilisée, ce qui entraîne un préjudice d’image important. L’entreprise devra alors gérer sa communication et son discours dans les médias. Surtout, il est important d’avoir d’excellents juristes maîtrisant les 2 facettes droit pénal/arsenal législatif et droit du travail, d’établir une relation de confiance avec l’inspection du travail et de prendre en compte l’importance des délégations de pouvoir. »
David JONIN,
avocat associé,
GIDE LOYRETTE NOUEL.
« La prévention des risques passe par des formations et des audits réguliers, des procédures transparentes et surtout par une définition claire et un suivi des délégations de pouvoir afin de s’assurer qu’elles sont valables. »
Stéphanie LECERF,

« Pour limiter les risques, plusieurs bonnes pratiques peuvent être mise en place : il faut s’assurer de l’efficacité des délégations de pouvoir, elles doivent être décidées au bon niveau de l’entreprise et par les bonnes personnes. Il est également important pour l’entreprise/les juristes de s’intéresser aux activités de l’entreprise, à la pratique et pas seulement au code pénal. En cas de problème, il est majeur d’avoir un point d’entrée par un interlocuteur unique. La formation des équipes est également essentielle pour leur apprendre notamment comment réagir en cas d’audition. Il convient d’entretenir aussi de bonnes relations avec les autorités et de savoir gérer les médias en développant des compétences en matière de communication pour éviter les impacts sur la réputation. »
Marie-Lucie DUBOIS,
responsable contentieux social,
AIR France.
::: JURISTE, UN JOB EN MUTATION : Quelles compétences développer d'urgence ?
Etude de L’EDHEC et de l’AFJE
Plus de 89% des juristes ont intégré l’idée que la transition digitale des directions juridiques a ou aura un impact fondamental et durable sur leur méthode de travail. Un nouveau défi attend les juristes : face à ces enjeux, quelles nouvelles compétences les juristes doivent-ils développer ? Quelles compétences humaines la machine n’aura-t-elle jamais ?
Lors du Business & Legal Forum, décryptage avec l’étude menée par l’EDHEC et l’AFJE et auprès de 100 leaders juristes, avocats…
::: JURISTE : LE CHANGEMENT A DEJA COMMENCE

« Quand le juriste a un projet, le service financier, le service de la communication et le business leader travaillent avec lui. Il faut donc des juristes capables d’interagir et en ce sens, cela change leur profil. »
Stéphanie FOUGOU,
secrétaire générale, INGENICO,
présidente d’honneur, AFJE.

« Aujourd’hui, nous cherchons des juristes ayant une capacité d’adaptation au monde de l’entreprise, une capacité de travailler en mode projet. Aussi, quand nous recrutons un directeur juridique, nous recherchons des qualités proches de celles d’un dirigeant. L’objectif est qu’il soit au cœur de la stratégie et de la vision de l’entreprise. »
Arnaud de BONNEVILLE,
associé,
TILLERMAN.
::: QUELLES VALEURS AJOUTEES POUR LE BUSINESS ?
« Les juristes vont profiter des outils du digital et de la legaltech pour avoir des taches à valeurs ajoutées pour le business. »
Arnaud de BONNEVILLE,

« Avec les nouvelles technologies, tout le temps que passaient des équipes à faire de l’analyse d’informations juridiques va être réduit et remplacé par un meilleur accompagnement du client. »
Christophe ROQUILLY,
professeur, doyen de la recherche et du corps professoral, directeur LegalEdhec Research Centre,
EDHEC.

« Le juriste a une spécificité car il accompagne les projets de court terme tout en ayant une vision de long terme, ainsi c’est un peu un gardien du temple. »
Stéphanie FOUGOU,
secrétaire générale, INGENICO,
présidente d’honneur, AFJE.
::: FORMATION : UN NOUVEAU REFERENTIEL DE COMPETENCES A DEVELOPPER ?
« A l’EDHEC, l’objectif est de créer pour le marché du droit un référentiel de compétences du juriste (au sens large, et donc aussi avocat, notaire, etc.) augmenté. L’intérêt de le mettre en mode wiki est de pouvoir le mettre à jour, avec un Comité Wiki composé d'experts : certaines compétences ne seront plus prioritaires et d’autres vont le devenir. Egalement, ce référentiel pourra être customisé pour les besoins spécifiques de directions juridiques, de cabinets, etc. Certaines compétences sont facilement certifiables en ligne mais certaines pourront être mesurées par un accompagnement des talents et des faiblesses en entretien. »
Christophe ROQUILLY,

« L’industrie du Droit est une industrie de Talents. Ce referenciel a vocation à être un outil de talent management du droit pour accompagner les directions juridiques, les cabinets, les professionnels du droit dans leur transformation. »
Jérôme FRIZZERA-MOGLI,
entrepreneur, chercheur associé,
LegalEDHEC Research Centre, EDHEC.

« Nous ne sommes pas encore à l’ère où ce sont les robots qui vont pouvoir remplacer à 100% l’humain. Nous avons besoin de l’expérience du RH ou du chasseur de tête à l’embauche et de l’expertise du juriste. »
Arnaud de BONNEVILLE,
associé,
TILLERMAN.
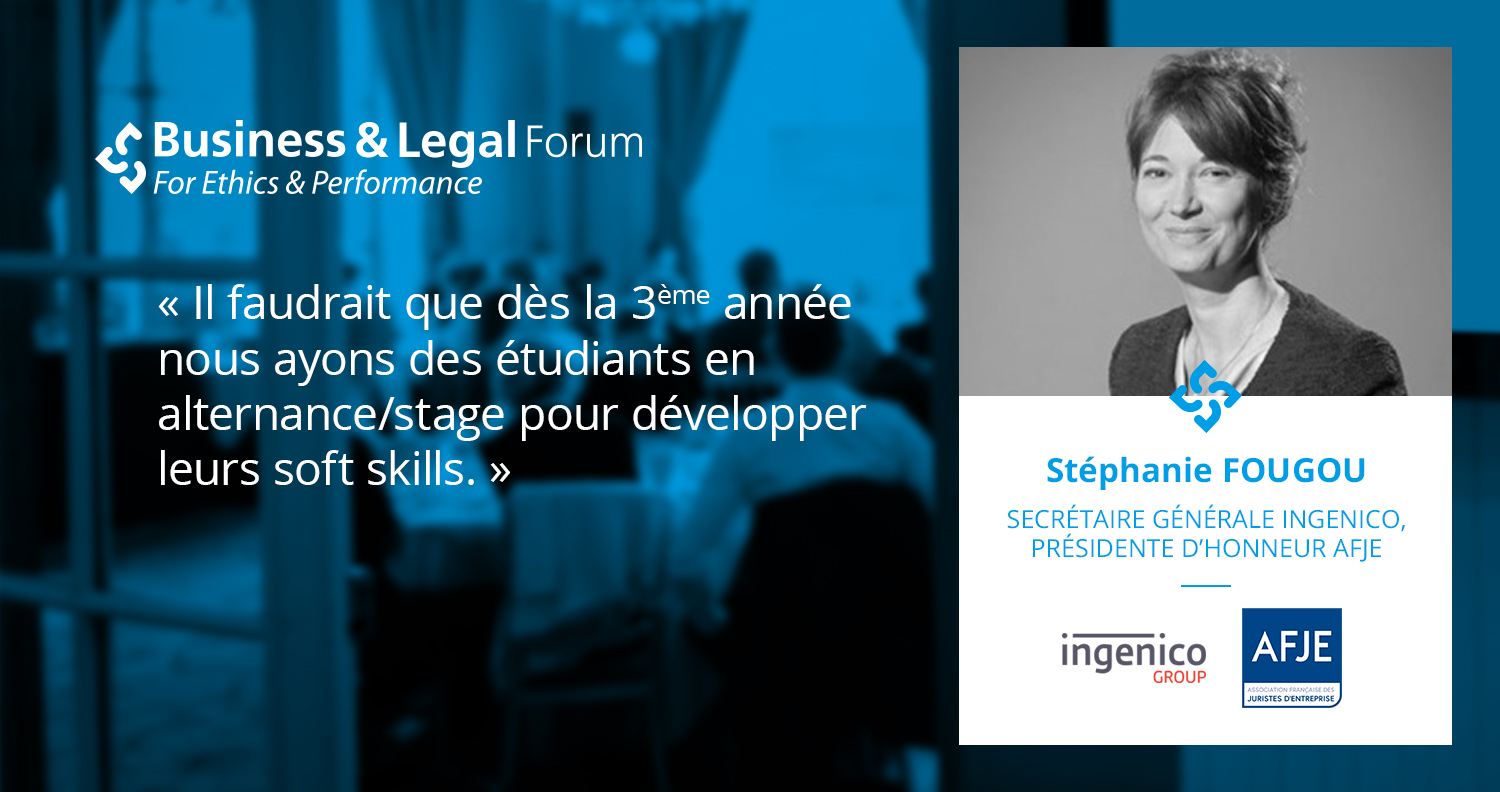
« L’université s’améliore mais il doit y avoir des ponts avec l’entreprise qui doivent évoluer. Le droit change beaucoup donc il faudrait peut-être plutôt apprendre des typologies, « apprendre à apprendre le droit » et être capable de lire un bilan. Il faudrait que dès la 3ème année nous ayons des étudiants en alternance/stage pour développer leurs soft skills. »
Stéphanie FOUGOU,
secrétaire générale, INGENICO,
présidente d’honneur, AFJE .
::: FONCTION CONFORMITÉ : LES PRIORITÉS
Retour sur notre déjeuner consacré au « Directeur conformité, comment être conforme au guide AFA sur la fonction conformité ? Quels critères privilégiés d'urgence et/ou prioritairement ? ».
L’AFA décrit dans son guide une fonction compliance « idéale ». L’exigence est élevée et dépasse les dispositions de la loi Sapin 2, dès lors, comment organiser sa fonction conformité selon l’organisation et les moyens de son entreprise ? A partir de quel niveau est-il possible de considérer que la fonction conformité correspond aux critères de l’AFA ?
Lors d’un déjeuner du BLF, quelques priorités pour répondre au guide AFA se sont imposées :

::: 1re PRIORITÉ :
LA FONCTION CONFORMITÉ, UN INDISPENSABLE
« Le responsable de la conformité n’est pas une création de la loi, mais bien celle de l’AFA. L’agence s’est rendue compte que la designation d’un responsable de la conformité par l’entreprise était indispensable pour déployer et faire vivre le programme anticorruption. L’existence de ce responsable, les moyens dont il dispose, sont pour l’ AFA un indicateur de la maturité anticorruption de l’organisation. »
Franck VERDUN,
avocat associé,
VERDUN VERNIOLE.

« Le compliance officer doit à être à jour au niveau juridique, l’idéal étant qu’il soit également juriste car confronté à des situations réelles difficiles.»
Anton CARNIAUX,
directeur juridique et compliance,
SAMSUNG FRANCE.
::: 2e PRIORITÉ : QUELS MOYENS ALLOUER ?

« L’AFA considère que l’organisation et les ressources allouées à la fonction conformité par les entreprises est un marqueur de leur maturité en matière de prévention de la corruption. L’ AFA a donc établi un guide sur la fonction conformité permettant aux entreprises d’évaluer leur propre dispositif et le faire évoluer, le cas échéant. Ce guide entre dans le référentiel anti-corruption et sera en conséquence examiné par l’ AFA en cas de contrôle. »
Franck VERDUN,
avocat associé,
VERDUN VERNIOLE.

« Sur le sujet complexe de la mise en place des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs et intermédiaires, le Groupe NGE a voulu s’adjoindre l’expertise d’un prestataire anglo-saxon afin de lui permettre de mener des « dues diligences » à l’égard de ces derniers. Le Président de NGE a accueilli les obligations de prévention de la loi SAPIN 2 comme une opportunité et doté le Comité Ethique - qu’il préside - en charge de leur mise en place, de moyens adaptés. Sur le dispositif de formation qui me concerne plus particulièrement, il veille à ce que les opérationnels assistent à la formation présentielle. »
Sabine IBANES,
responsable juridique,
NGE.
::: 3e PRIORITÉ : INNOVER DANS SA COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

« La manière de communiquer en matière de corruption est importante : comment faire pour sensibiliser sans terroriser ? »
Marie BATUT-DAJEAN,
directrice juridique,
ELIOR.

« Le souci n’est pas de sensibiliser les instances dirigeantes, ils y sont sensibilisés. Le problème est de maintenir une pression positive au niveau du terrain. »
Florence DEMEME,
directeur de la conformité,
BPE.
::: UN APPEL A UNE HARMONISATION INTERNATIONALE
Un élan international est souhaité afin d’assurer une certaine équité économique entre les acteurs.

« Le plus dur, c’est d’exister en tant qu’entité française dans un groupe international car les réglementations sont différentes selon les pays (cf : loi Sapin II) ».
MARTIN SCHIFF,
administrateur, membre du comité d’audit et de compliance,
SAIPEM SA.
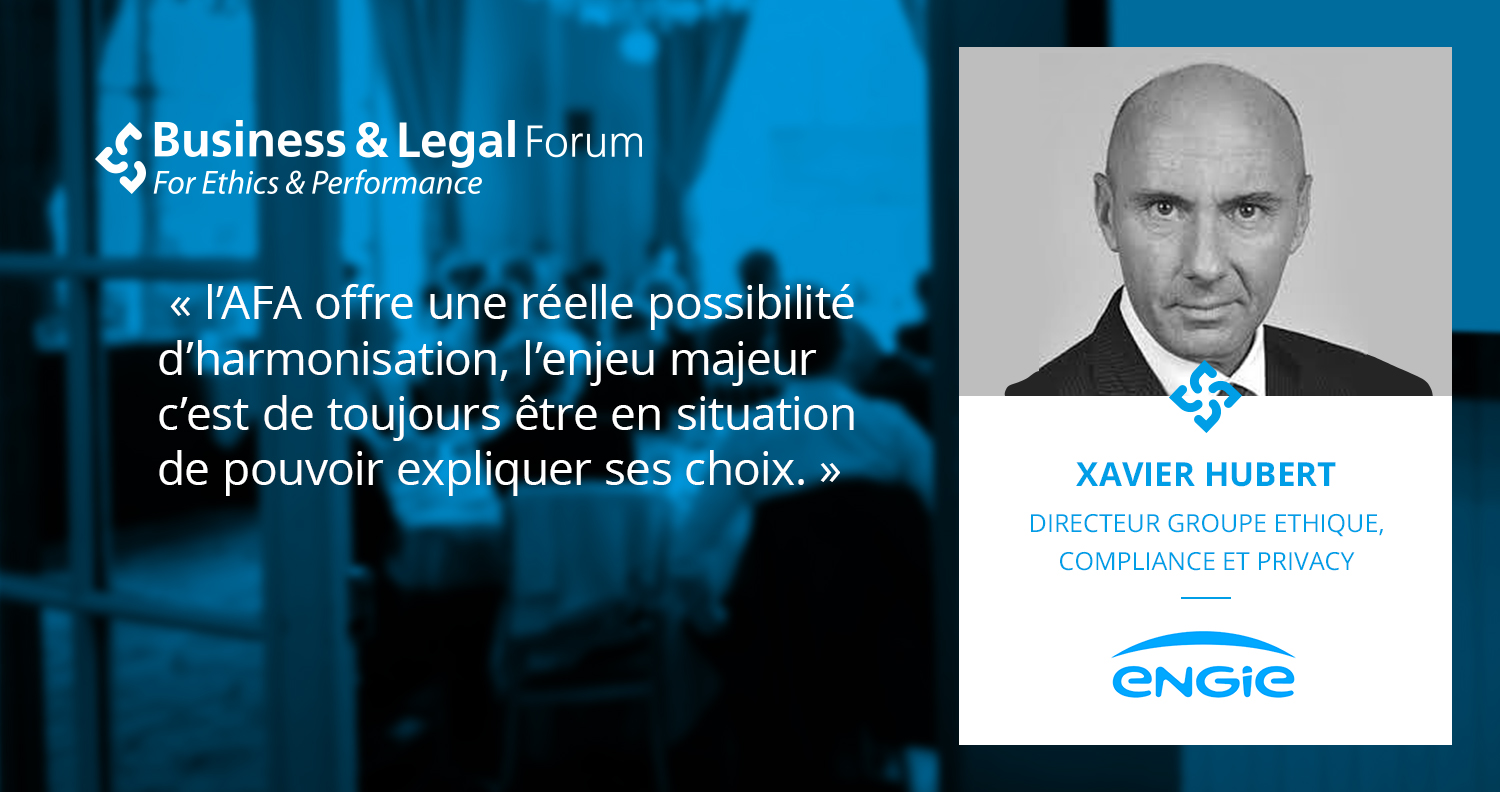
« Les lignes directrices de l’AFA offre(nt) une réelle possibilité d’harmonisation mais il faut néanmoins pouvoir aussi faire-valoir des différences. L’enjeu majeur en réponse aux interrogations des autorités de régulation, c’est de toujours être en situation de pouvoir expliquer ses choix. »
Xavier HUBERT,
directeur groupe éthique, compliance et privacy,
ENGIE.
::: ARBITRAGE : RÉDUIRE LES DÉLAIS
Retour sur notre déjeuner consacré au " Temps de l'arbitrage. Comment réduire les délais pour une meilleure efficience ? " et donc les coûts... avec la présence exceptionnelle d'Alexis MOURRE, président de la cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.
Voici un extrait de quelques pratiques à retenir :

::: LA DISPONIBILITÉ DES ARBITRES
« Concernant la déclaration de disponibilité, nous veillons à ce que les arbitres déclarent tous leurs engagements sur une période de deux ans, afin d’assurer une complète transparence. Ces déclarations sont communiquées aux parties, et en cas d’objections, la Cour apprécie s’il y a lieu de refuser la confirmation de l’arbitre en question. Dans des situations d’incompatibilité manifeste, la Cour peut refuser de confirmer de sa propre initiative. »
Alexis Mourre,
président de la Cour internationale d’arbitrage,
ICC.
::: ENCADRER LE VOLUME DE LA DOCUMENTATION
« Un des problèmes générateurs de surcoûts dans l’arbitrage est la répétition des mêmes arguments par les parties dans leurs différentes soumissions et dans les déclarations de témoins. Nous assistons cependant aussi, et cela est positif, à une plus grande disponibilité des arbitres à traiter de certaines questions à une étape plus précoce de la procédure, en particulier par le moyen de bifurcations. »
Alexis Mourre,
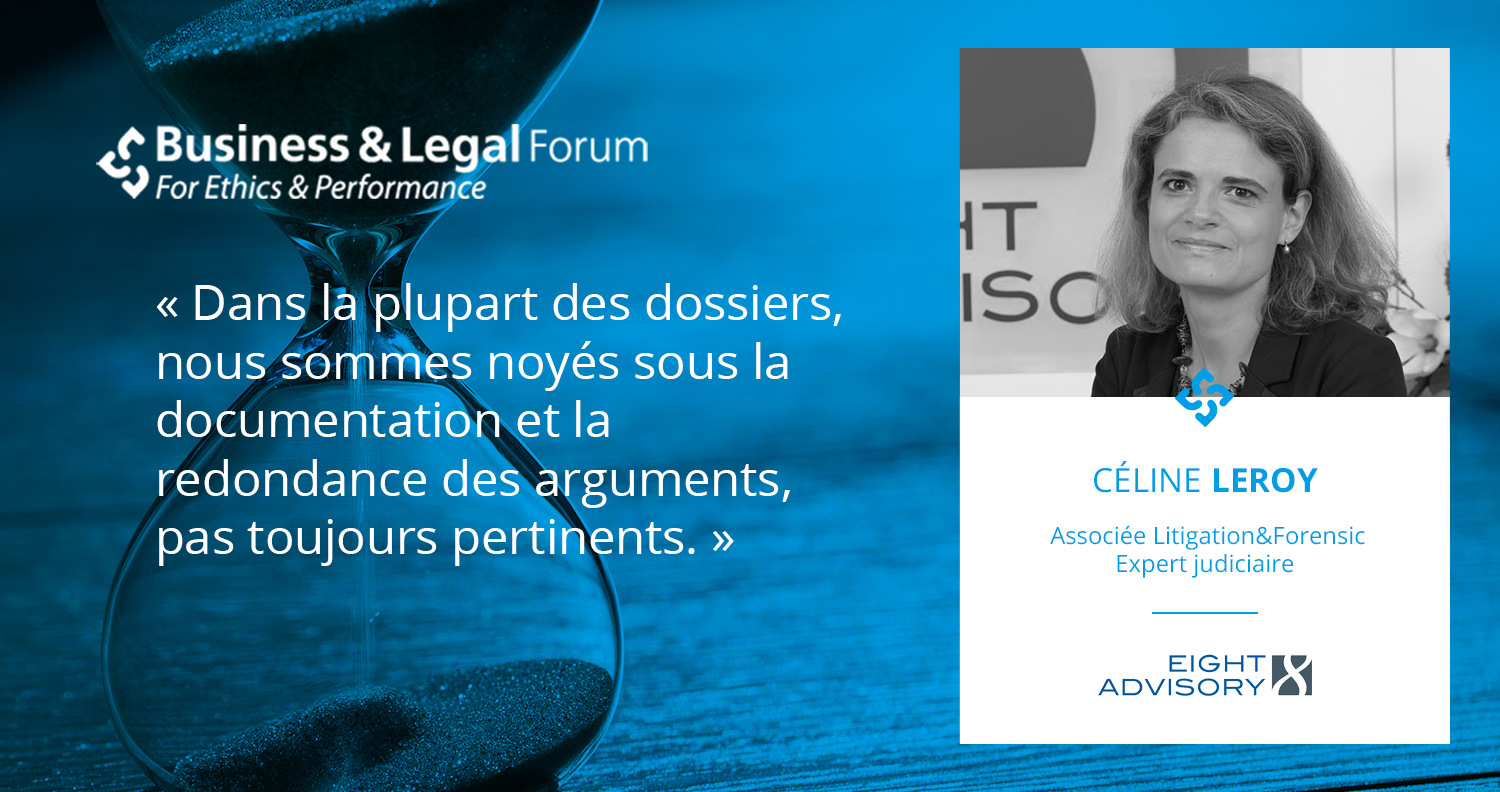
«Dans la plupart des dossiers, nous sommes noyés sous la documentation et la redondance des arguments, pas toujours pertinents. Les solutions à trouver pour plus d’efficacité résident dans l’identification des points de désaccord et la recherche de leur seule résolution. Par exemple, i) par des sessions de hot-tubbing plutôt que de cross-examination avec l’établissement d’une liste conjointe établies par les arbitres et parties des thématiques souhaitant être abordées et ii) l’établissement d’un document de synthèse par les arbitres, préalable à la sentence, et donnant leur compréhension du dossier et leur position envisagée si aucun nouvel élément pertinent venait à être versé».
Céline Leroy,
associée litigation & Forensic - expert judiciaire,
EIGHT ADVISORY.

«On a parfois des écritures de 800 pages et des témoignages qui peuvent faire 300 pages. Il y a une certaine redondance dans les différents jeux d’écritures qui rend la procédure plus lente. On a besoin d’encadrement et je pense qu’elle est possible à mettre en œuvre».
Charlotte Gaussel,
directrice juridique contentieux et arbitrage,
VEOLIA ENVIRONNEMENT.
::: ANTICIPER AVEC OU SANS PRISE DE RISQUES
« Face au risque qu’une partie conteste la reconnaissance ou l’exécution de la sentence devant les juridictions nationales au motif que le respect du contradictoire n’a pas été respecté, certains arbitres ont tendance à accepter trop facilement des demandes manifestement dilatoires qui allongent les délais. Il ne faut pas suivre cette tendance du zéro risque au détriment du respect de l’efficacité de la procédure et de son coût ».
Xavier Nyssen.
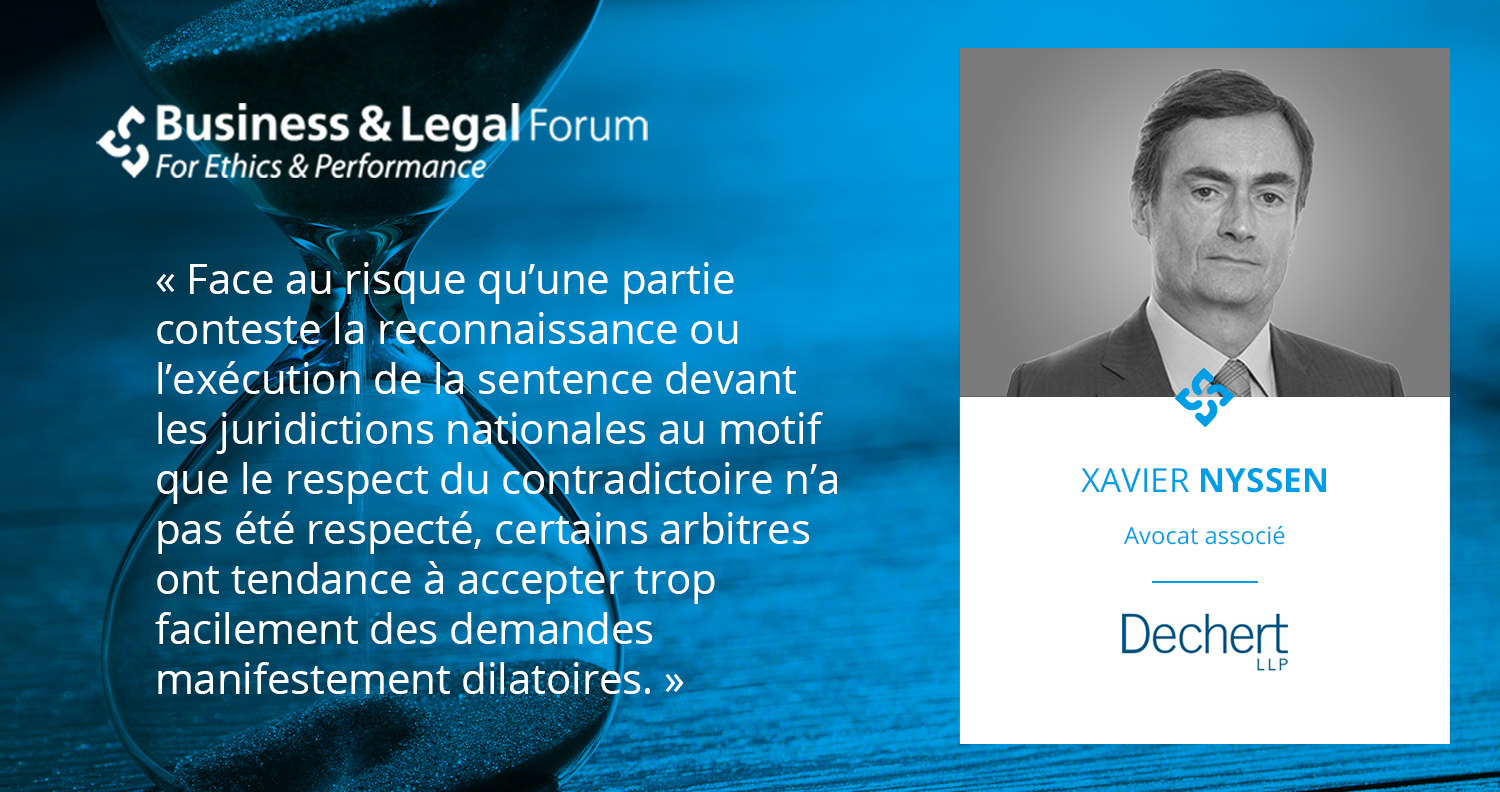
« Il n’est pas aisé d’identifier le type de litige qui pourrait intervenir au moment de la rédaction du contrat. Ce qui explique le recours aux modèles standards de clause de résolution des conflits. Si on peut anticiper que les enjeux seront limités, la clause peut être adaptée, en prévoyant par exemple le recours à un arbitre unique, un nombre limité de mémoires ou une procédure écrite, sans audience de plaidoirie ».
Xavier Nyssen,
avocat associé,
DECHERT LLP.

« Lorsque l'intervention d'un expert est utile pour déboucler un litige sur des questions techniques, il peut être pertinent de dresser à l'avance une liste d'experts compétents selon l'affaire concernée. Cette liste d'experts déterminée lors de la conclusion du contrat permet d'optimiser la gestion du temps dans une phase de procédure de résolution des litiges. L'existence d'une liste (par opposition à la désignation d'un expert unique) permet de palier à une potentielle situation de conflit d'intérêt qui existerait au moment de la procédure. La détermination préalable des experts gagnerait à se développer et constitue un outil pratique et facile à mettre en œuvre».
Noria Hitache,
directrice juridique et conformité,
FINANCIERE CEP.
Vous souhaitez être mis en contact avec l'un des participants : connectby@businessandlegalforum.eu
Recevoir des invitations ou informations du Business & Legal Forum :
EXCLUSIF :::
LES GRANDS ENTRETIENS
Le droit et les juristes
vus par les dirigeants
Après l’étude 2016 réalisée avec l’EDHEC, quelles sont les tendances 2018 ? INÉDIT : Après plusieurs heures en tête à tête avec des présidents, DG, membres de COMEX du CAC 40, du CAC All-Tradable, nous avons des choses à vous raconter : et vous serez sans doute surpris !
Quelle est leur perception du droit et des juristes ?
Quel rapport au risque attendent-ils que les juristes adoptent ?
Quels sont les critères de confiance et de performance à utiliser ?
Et aussi, quels sont leurs avis sur la question de l'externalisation, le positionnement des juristes dans l'entreprise, la place de ces derniers dans le comité exécutif, les principales sources de création de valeur par le droit qu'ils identifient....
Une étude qualitative totalement exclusive et unique en son genre, qui vous donnera les clefs pour projeter la pratique du droit dans le futur et être en phase avec les attentes des dirigeants, voire les devancer !
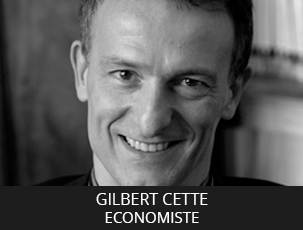
INSPIRATION(S)
Et côté économie ?
Gilbert Cette : Associer pleinement les salariés aux orientations stratégiques de l’entreprise est la condition d’une implication qui permet d’améliorer à la fois l’efficacité économique et la satisfaction des travailleurs. Elle relève en cela de la même logique qu’une présence et participation effective de représentants des salariés au Conseil d’Administration. L’initiative « One planet, One Health » est un moment fort de la vie de Danone pour définir de grands choix concernant son avenir.

INSPIRATION(S)
En voiture Simone ! Si personne ne conduit, qui paye l'amende ?
Vers 2020, vous pourriez enfin aller en voiture autonome à Deauville (flâner sur les planches) ou à Correns (boire un verre de rosé avec Brad ou Angelina selon vos préférences). Cet objectif prioritaire pour le président de la République, vient d’être confirmé par un rapport confié à Anne-Marie Idrac
PORTRAIT
Maria Pernas, une directrice juridique passionnée, connectée et résolue chez CapGemini.
Ayant eu très tôt l’opportunité d’une carrière internationale dans le monde de l’entreprise, Maria Pernas préféra finalement le droit à la diplomatie. Sa brillante carrière la mena de l’Espagne où elle est née, à Rome, à Paris et dans les nombreux pays dont elle eu la responsabilité en tant que directrice juridique.

INSPIRATION(S)
Danone révolutionne sa gouvernance.
"Je suis convaincu que cette gouvernance participative sera un incroyable avantage concurrentiel pour maîtriser collectivement les nouveaux paradigmes." déclare Emmanuel Faber, son président.

INSPIRATION(S)
Quel est l’impact sur la motivation des salariés ?
Bertrand Austruy : Nous croyons que chaque fois que nous mangeons et nous buvons, nous votons pour le monde dans lequel nous voulons vivre. D'ici la fin de l'année, chacun des salariés de Danone sera invité à s'engager activement et à inventer l’avenir en contribuant à la construction de la feuille de route des Objectifs Danone 2030.
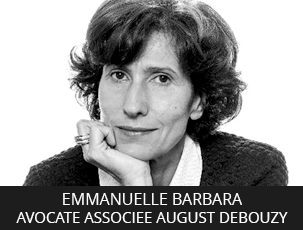
INSPIRATION(S)
Est-ce une bonne idée ? Pourquoi ?
Emmanuelle Barbara : Le triptyque, raison d’être de l’entreprise, association des salariés à la stratégie, partage de la valeur, est le socle sur lequel la grande entreprise doit penser son pacte social.

INSPIRATION(S)
« Savourer sa victoire - que ça soit un marché ou le tournoi des VI Nations – ça n’a pas de prix. Mais si l’on n’a pas respecté les règles, est- ce une victoire ? » interroge Marc Liévremont ancien joueur international de rugby et entraineur du XV de France.
Avec la sémantique du sport, moins feutrée que celle des affaires, il donne le LA.On s’est attaqué aux tricheurs, il y a une cinquantaine d’années avec la création de l’agence de lutte contre le dopage alors que l’Agence française contre la corruption a 1 an. Inutile de faire un dessin.
INSPIRATION(S)
La compliance : un enjeu géopolitique et de sécurité !
La compliance nous surprend et comme souvent à toute nouveauté, on résiste en la qualifiant de contraintes administratives sans valeur. Et si l’on s’interrogeait sur les vertus de la compliance ? La compliance à la française est aussi une démarche voulant corriger une asymétrie entre l’Europe et les Etats-Unis dans la lutte contre la corruption, notamment.

INSPIRATION(S)
La compliance n’est-elle rentable qu’en cas de condamnation ?
Travailler la perception et la crédibilité de sa compliance sont donc deux objectifs majeurs. Selon la perception qu’en ont les collaborateurs, les pratiques de compliance d’une entreprise seront plus ou moins acceptées, mises en œuvre et feront - ou pas - l’objet d’une attention réelle afin d’être améliorée.

INSPIRATION(S)
Sillicon Valley :
un voyage au cœur du territoire le plus influent au monde.
Le mois dernier vous rêvions la France en tête de peloton de la voiture autonome. Et bien, ce ne sera pas pour cette fois. La Californie a été plus rapide. Alors nous vous invitons à visiter un petit morceau de cet Etat, qui influence le monde et nos vies plus que n’importe quel autre espace dans le monde. Avec l'hebdo Le 1 parcourez la vallée, ses lieux de pouvoir et ceux de contestation. Retracez son développement économique et idéologique, de la ruée vers l’or aux Gafa. De quoi comprendre les motivations et projets qu’elle suscite et les désillusions qu’elle génère...

PORTRAIT
La carrière de haut vol d'Helen Brown, avec l'équilibre et l'enthousiasme comme moteurs.
De l’Irlande où elle est née à la direction juridique monde d’Axa, voici le parcours d’une femme ayant relevé haut la main le défi d’une carrière de haut vol conciliée avec une vie de famille équilibrée. L’évolution du métier, les envies qui changent et la recherche de l’enthousiasme…
Bonjour Helen, d’avocate chez Linklaters vous êtes devenue directrice juridique du groupe Axa. Pourquoi ce changement ?

INSPIRATION(S)
Le droit et les représentants d'intérêts. Discuter ou capturer la décision publique ?
D’un côté, et depuis longtemps, on critique le manque de connaissance des réalités de l’entreprise (étude) par les pouvoirs publics. Mais de l’autre on critique le pantouflage et les aller-retour des hauts fonctionnaires dans le privé (article). Par ailleurs, on critique le manque de prise en compte de l’intérêt général par les entreprises (cf. notre sujet suivant) tout en demandant aux administrations de se comporter comme des entreprises. Entre temps, on continue d’en appeler à toujours plus de transparence et à une meilleure consultation lors de la fabrication du droit...

PORTRAIT
Une directrice juridique chez les ingénieurs
Bonjour Quitterie de Pelleport. Directrice juridique du groupe Solvay, c’est un beau poste. Vous êtes par ailleurs rattachée à votre président. Les challenges ne doivent pas manquer…
Bonjour, Merci ! En effet, dans un grand groupe comme Solvay, quand le droit est perçu comme l’un des ingrédients du succès de l’entreprise, le challenge est permanent.
Si Jean-Pierre Clamadieu souhaite vous avoir à ses côtés, ce n’est sans doute pas pour rien ?
INSPIRATION(S)
Efficacité de la loi et crédibilité vs marketing politique et lobbying à courte vue...
Trop de loi ? Est-ce vraiment là, le problème ? On en doute, à écouter Denis Baranger, professeur de droit, parler de son dernier ouvrage « Penser la loi ».
« Si l’on accepte que le droit c’est avant tout des idées portées par le politique, le problème n’est pas d’avoir trop de lois mais qu’elles soient décevantes et inutiles. ».
.

INSPIRATION(S)
Paradise Papers : à quoi sert le droit si la légalité n'est plus suffisante ?
Paradise Paper : la fiscalité, la morale, la réputation et les juristes… Voilà un beau sujet. Et le hasard nous a fait trouver ce passage des « Pensées sur la morale » d’André Comte-Sponville : "La morale n'est légitime qu'à la première personne. La morale ne vaut que pour soi ; pour les autres, la miséricorde et le droit suffisent. ».

Florence Henriet, FHP Conseils
INSPIRATION(S)
Avocats, comment industrialiser l’intuiti personae et favoriser son business développement ?
(Directeurs juridiques, ça peut vous donner des idées pour vos clients internes !)
Comment concilier spécificités du métier d’avocat d’affaires, gestion du temps et business développement ?

INSPIRATION(S)
Lobbying et transparence : nouvelles obligations pour les "influenceurs" mais l'anonymat demeure pour les "influencés" !
Les affaires publiques et l’influence en France vont devoir revoir leurs pratiques. Sapin 2 souffle sur elles un vent nouveau !
Pour la première fois, la France se dote en effet de dispositions générales législatives et réglementaires d’encadrement de l’action des représentants d’intérêts auprès des pouvoirs exécutif, législatif, des élus locaux
Geneviève VAN ROSSUM, le député Dominique POTIER, François-Guy TREBULLE Julie VALLAT, Christian DARGHAM.
INSPIRATION(S)
" Business or human rights ? "
Tonnerre de Brest, les deux !
A l’image du très sévère Modern Slavery Act (RU) et de la loi sur le devoir de vigilance (France).... Voici quelques verbatim de la rencontre du 31/01 dernier avec Dominique Potier, député, auteur de la proposition de loi
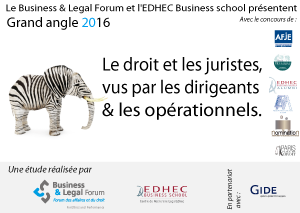
GRAND ANGLE 2016
ÉTUDE
Quelles perceptions et quels regards ont les non juristes sur le droit et ses praticiens ?
Déjà réalisée en 2009 et 2010, les choses ont évolué. Mais dans quel sens ?

Raphaël Coin, directeur fiscal France,
General Electric
INSPIRATION(S)
GOUVERNANCE FISCALE DES ENTREPRISES : sous pression juridique, politique et médiatique. Optimisation, transparence, éthique... Quels enjeux ? Comment y faire face ?
Pression internationale via l’OCDE. Enquêtes de la Commission européenne. Fuite des Panama Papers. La pression sur les entreprises en matière fiscale est à son comble.
Bill Leon, ancien procureur fédéral US
INSPIRATION(S)
ENQUÊTES COMPLEXES, MULTI JURIDICTIONNELLES, CORRUPTION, CONCURRENCE, FISCALITÉ...
Faut-il se défendre ou coopérer ?
4 questions, 8 réponses dont celle d'un ancien procureur fédéral américain.
"infractions complexes dans un monde complexe..."
Alexandre MENAIS, Executive vice president M&A and corporate development, ATOS

INSPIRATION(S)
ARBITRAGE & CONTENTIEUX.
Comment faire face aux dérives des expertises financières dans l’évaluation des préjudices ?
Peut-on parler de dérives ?
Le mot est un peu fort pour certains. Néanmoins, la sophistication des expertises entraîne des difficultés de lisibilité, des coûts en perpétuelle croissance, des points de friction.
Est-il possible d’encadrer la surenchère des expertises financières lors de l’évaluation des préjudices ?
Quelles sont les marges de négociation ?
Quelles sont les attentes des juges, des arbitres, des parties ?
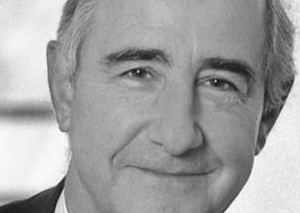
Michel Prada, Président, HCJP
INSPIRATION(S)
PARIS, PLACE FINANCIÈRE EN PERTE DE VITESSE
L'outil juridique a sa rescousse ?
Le Haut comité juridique de place inversera-t-il la tendance ? Au terme de l'année 1, comment évaluer son efficacité ? Comment construire une place attractive : mix de performances économiques et d'innovations
juridiques ? Regards croisés de l’équipe mise en place, d’une spécialiste du lobbying et de l’influence et d’un acteur reconnu de la place.
"Je regrette qu'il n'y ait pas d'utilisateurs finaux des outils juridiques, au sens d'acteurs impliqués directement et quotidiennement sur les marchés, des non juristes."
Bruno de PANPELONNE, président,
Tikehau IM
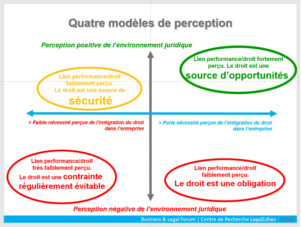
ÉTUDE
LE DROIT ET SES PRATICIENS VUS PAR LES DIRIGEANTS
" Les dirigeants ont majoritairement une vision traditionnelle du juriste, il est considéré comme un conseil, et très minoritairement comme un stratège dont le rôle est :
- La défense des intérêts de l’entreprise dans le cadre d’une procédure,
- La garantie de la sécurité contractuelle,
Quelques dirigeants attendent plus de leurs juristes et notamment de les informer sur les opportunités que le droit peut offrir.
Cette étude a été conduite auprès des présidents, DG de grands groupes et de PME et réalisée avec l’EDHEC Business School et avec le soutien de l’IFA et l'association des anciens élèves de l’ENA.
Les résultats de cette étude exclusive ont été présentés lors de l’édition annuel du Business & Legal Forum. Ils ont fait l’objet d’une reprise en avant-première dans le Figaro.
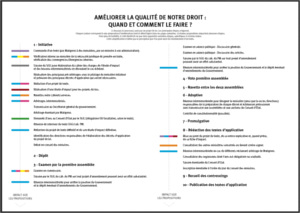
G.Larcher, G. Ramex, G. Briatta...
ÉTUDE
QUALITÉ DU DROIT.
Objectifs confiance et compétitivité. Quelles efficiences ?
Regards croisés des mondes de l’entreprise et des pouvoirs publics.
Simplifier le droit, tout le monde est pour.
Mais plus que d’un droit simplifié, notre économie a avant tout besoin d’un droit de qualité.
Le Business & Legal Forum s’est attaché à rencontrer une trentaine de personnes, juristes et non juristes, issues des pouvoirs publics, des entreprises, des associations et syndicats.
Une étude réalisée en partenariat avec Communication & Institutions et Jeantet Associés.
LIRE L'ETUDE...

Laurent Schmitt , Vice-Président Smart Grid, ALSTOM GRID | Nommé comme l'une des 40 personnalité les plus influente du smart grid en Europe.
INSPIRATION(S)
OBJETS CONNECTES, SMART GRID, MULTIPLICATION
DES BESOINS, RAREFACTION DES RESSOURCES : La « DATA » le nouveau maître du monde.
Les réseaux intelligents redessinent les secteurs traditionnels (énergie, eau, déchets, trafics urbains et routiers…). Des nouveaux business models apparaissent. Mais les équilibres entre acteurs sont bouleversés. La collaboration entre les experts techniques, économiques et juridiques sera l’une des clefs de succès.Dès lors, comment les acteurs s’adaptent-ils à cette nouvelle donne ? Points de vue croisés de cinq acteurs d’avant-garde.
"Articuler innovations technologiques et innovations juridiques"
Yves Prufer, directeur de l'Agence Métropolitaine de la Performance Energétique chez Métropole Nice Côte d'Azur (NCA).

Véronique QUEFFELEC, directeur du développement, Euromédiations,
administrateur, Euromax capital Ltd, RUIA Group
INSPIRATION(S)
MARCHE FINANCIER PARISIEN :
UNE BOUTIQUE A REDORE
 |
Véronique QUEFFELEC Euromédiations, Euromax capital Ltd, RUIA Group |
"Nous ne jouons pas quand l'arbitre change les règles au milieu de la partie."
Cette remarque de grands fonds d'investissement américains lassés de l'imprévisibilité française (rétroactivité des lois fiscales, modifications législatives à répétition, risque social réel inconnu -car non évaluable- résume partiellement la désaffection de la place parisienne. Le plan de compétitivité Gallois étonnamment leur semblait prometteur. Tel un symbole de nouvelles bases juridiques pertinentes, ou l'amorce de fin de l'illisibilité du marché financier français. Son abandon, que nous situons précisément à l'époque de l'ouragan Sandy, a clairement sonné le glas de leur intérêt hexagonal, ainsi que celui d'investisseurs d'autres pays.

















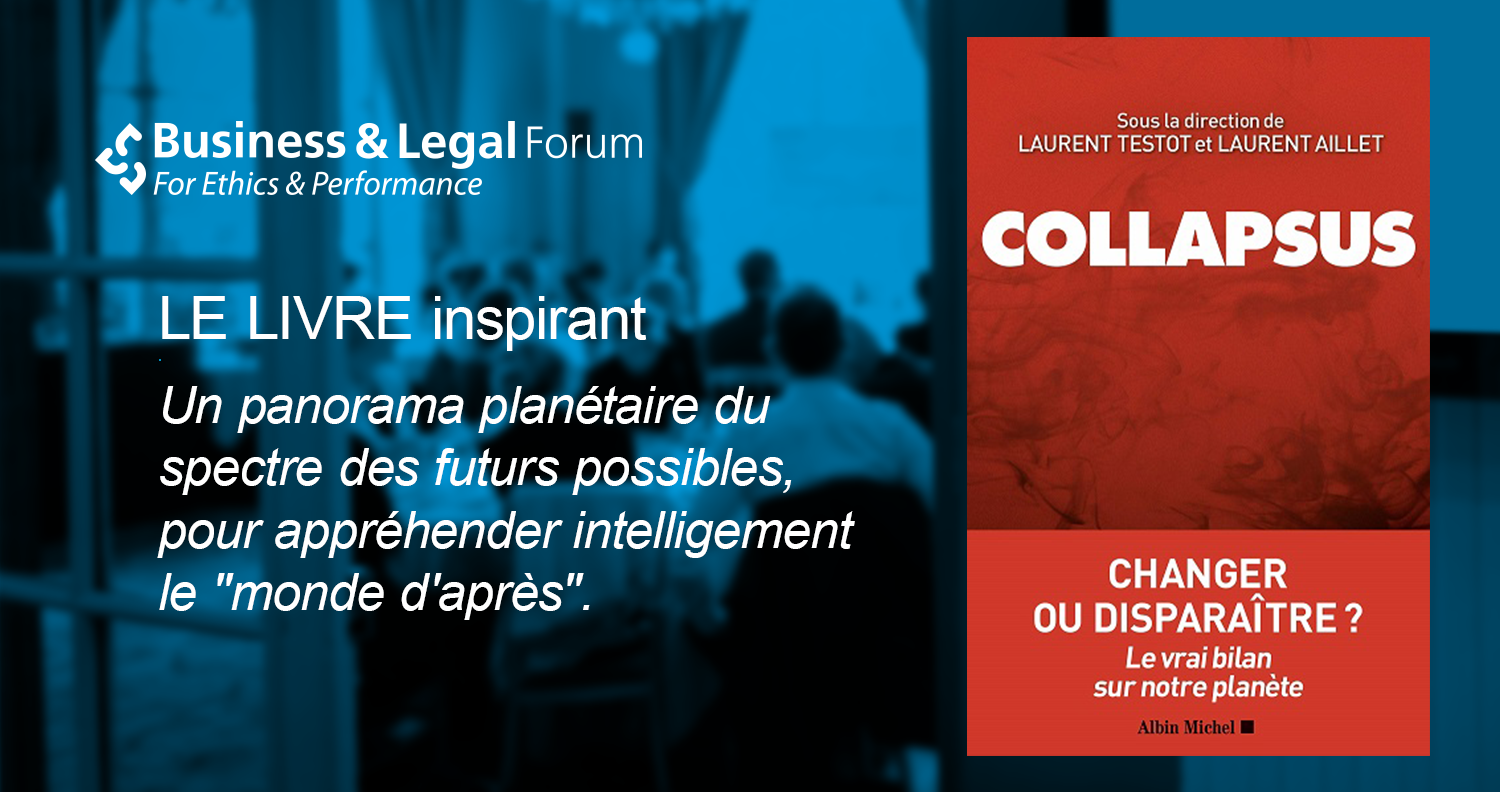




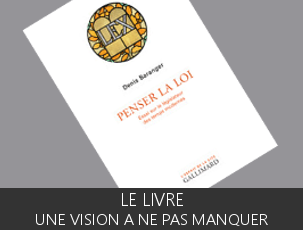

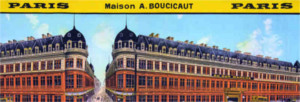
 Point de vue
Point de vue